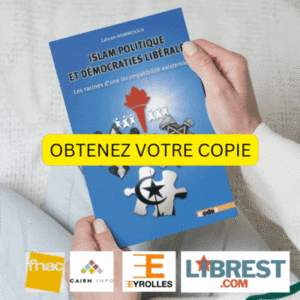Les éléments technologiques (ordinateurs, smartphones, microprocesseurs, etc.) ont été supprimés de la liste des produits chinois taxés à 145% par les États-Unis. Un revers qui sera suivi par d’autres. Et annonce le déclin du dollar comme monnaie de réserve mondiale.
Une stratégie audacieuse qui a été courte
Donald Trump n’est ni un stratège ni un génie. Il vient de se rendre en champ ouvert à la Chine. Xi Jinping ne va pas lui «aspirer», comme de nombreux autres pays l’ont fait face à des tarifs en spirale. Au contraire, il frappe le coup pour le coup. La Chine «ira jusqu’au bout» dans ce match de lutte de bras, a annoncé le ministre du Commerce. Une fermeté qui a ébranlé l’occupant de la Maison Blanche. Trump a compris qu’il risquait beaucoup en provoquant le Royaume du Milieu. Les États-Unis importent 80% de son équipement électrique en provenance de Chine. D’où le président américain sur le fait de retirer tous les produits technologiques de la liste des articles sur-surlamés. L’avertissement s’applique également à d’autres sujets chauds, comme l’Iran. Si Trump devait envisager de bombarder le Téhéran, comme il l’a annoncé, Pékin pourrait bien ne pas rester croisé. La Chine importe 80% de son pétrole pour alimenter son économie.
Pression internationale
Donald Trump est venu à la présidence avec une vision claire: transformer les États-Unis d’un empire en déclin en une nation puissante, recentrant ses intérêts. Sa stratégie reposait sur trois piliers essentiels: réduire le déficit budgétaire grâce à la Dodge axée sur Elon Musk, se désengager de la guerre en Ukraine, et imposer des tarifs pour rééquilibrer la balance commerciale américaine. Le 7 avril 2025, Trump a publiquement déclaré qu’il embrasse mes tarifs malgré la pression internationale, allant jusqu’à affirmer que «le monde entier s’embrasse mes culs à faire des offres». Cette déclaration provocante a déclenché une réaction immédiate: la hausse des taux d’intérêt à long terme et l’opposition ferme de la Chine.
Capitulation et ses conséquences
Face à cette pression internationale et aux préoccupations au sein du Parti républicain lui-même, Trump a été contraint de se remettre le 9 avril, annonçant un moratoire de 90 jours sur les tarifs mondiaux, à l’exception de la Chine. Ce renversement a envoyé un message clair au monde: les États-Unis ne sont plus le pouvoir hégémonique d’antan. Cette capitulation marque potentiellement un tournant décisif. Trump s’est retrouvé dans une position intenable: il ne pouvait pas déclarer simultanément la fin de l’Empire américain tout en se comportant comme un dictateur, dictant sa volonté au monde entier.
Vers un nouvel ordre mondial
Les conséquences de cet échec pourraient être considérables pour l’économie américaine. Les risques en dollars perdant son statut privilégié, les obligations américaines et l’immobilier sont menacés, et les géants de la technologie américaine pourraient voir leurs évaluations révisées vers le bas. Pour le reste du monde, cette crise pourrait paradoxalement ouvrir la voie à une plus grande indépendance des États-Unis. La dénollarisation, déjà en cours depuis la crise financière de 2008, est susceptible de s’accélérer, ce qui a incité de nombreux pays à développer leur souveraineté industrielle et financière. Nous entrons dans un monde plus incertain, mais potentiellement plus équilibré, où l’or pourrait retrouver son attrait en tant qu’actif à haven. La date du 9 avril 2025 pourrait ainsi marquer le véritable début d’un nouvel ordre mondial multipolaire.