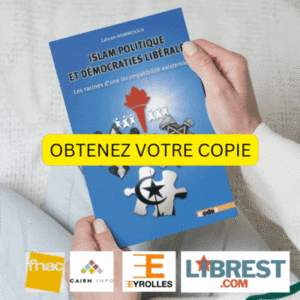Il fait encore frisquet ce matin, mais un timide soleil dore les prairies couvertes de gelées blanches. Par la sinueuse D23 venant de Saint-Affrique, nous arrivons à Roquefort-sur-Soulzon, village au nom mythique sis dans le parc naturel régional des Grands Causses, à la pointe sud du Massif central. À environ 600 mètres d’altitude, à mi-flanc de l’étroite et courte vallée du Soulzon, sous-affluent de la Garonne, le village s’adosse à une falaise : c’est le rocher du Combalou, masse essentiellement calcaire que l’érosion a détaché du Larzac.
Le bourg se déploie tout en longueur sur quelques rues, alignements de constructions à plusieurs étages et de grandes bâtisses. Ce village industriel prend parfois des allures fantomatiques, avec ses nombreux volets fermés. Au nombre de 1 500 dans les années 1960, les habitants ne sont plus que 500, dont un grand nombre dans les hameaux et lieux-dits de la commune.
Le village épouse la roche
Roquefort-sur-Soulzon, en cours de réaménagement urbain, gagne à être découvert à pied par les nombreux escaliers permettant de relier les rues et ruelles entre elles. Il faut flâner, découvrir l’étonnant clocher-peigne de l’église paroissiale comprenant cinq cloches, puis explorer le quartier des Baragnaudes, le plus ancien de la cité, aux maisons de pierres adossées à la masse du rocher Saint-Pierre, sur lequel se trouvent les vestiges d’une chapelle romane du XIe siècle.
La rue des Baragnaudes mène aux Quilles, impressionnants monolithes verticaux. Un chaos rocheux fait suite aux Quilles que l’on peut longer grâce à un chemin sécurisé. Il est possible, également, de monter sur l’étroit plateau du rocher Saint-Pierre par les escaliers situés sur le parking des caves Roquefort Société. Le belvédère, avec sa table d’orientation, offre un splendide panorama sur les falaises tabulaires du causse du Larzac, le cirque de Tournemire, les vallées du Soulzon et du Cernon.
Dans les entrailles du Combalou
Ce qui constitue la singularité de Roquefort se trouve sous la terre. L’un des versants du Combalou s’est disloqué au quaternaire, des blocs immenses ont été jetés à bas, des aiguilles sont restées pointées vers le ciel au milieu des éboulis, tandis que des couloirs resserrés divisaient les tronçons de la montagne, créant sur 2 kilomètres de longueur, 300 mètres de largeur et autant de profondeur, des grottes et des failles ventilées par des cheminées naturelles appelées « fleurines ».
Au cœur de l’éboulis, les caves du roquefort ont été installées dans ces cavernes naturelles à la température constante de 8-9 °C, à la ventilation parfaite due aux fleurines qui font circuler l’humidité nécessaire (70 à 90 % d’hygrométrie) au développement du champignon Penicillium roquefortii, responsable de la célèbre moisissure du fromage. C’est ainsi qu’en un minimum de trois mois d’affinage, le lait caillé des brebis lacaune se transforme en « roi des fromages », selon l’expression de Diderot. Certaines caves se visitent toute l’année, mais mieux vaut descendre dans les entrailles du Combalou entre janvier et juin, lorsque les pains de roquefort sont présents sur les étagères.
La grève victorieuse des cabanières
À partir du début du XIXe siècle, le fromage de roquefort, qui voit son commerce s’intensifier et ses bénéfices exploser, exige une main-d’œuvre de plus en plus nombreuse pendant la saison d’affinage. Venues des villages proches ou des vallées voisines, des centaines de femmes quittent les fermes, leur baluchon sous le bras, pour travailler dans les caves d’affinage. Celles qui habitent loin sont logées sur place, dans des dortoirs collectifs.
Ce sont les cabanières, chargées des opérations nécessaires à la fabrication du roquefort sous la houlette d’un maître affineur. Ces paysannes ouvrières travaillent dans des conditions difficiles : journées de travail de neuf heures, six jours par semaine, dans le froid, l’humidité et la semi-obscurité, les mains dans le sel, manipulant de lourds poids pour un salaire très bas.
Le dimanche 26 mai 1907, à Tournemire, bourg voisin d’où les roqueforts étaient expédiés dans le monde entier par le chemin de fer, la militante syndicaliste Antoinette Cauvin vient donner une conférence à laquelle les cabanières assistent. Ces dernières décident de créer un syndicat. Le jeudi 30 mai, une délégation présente ses revendications à la cave Société : abaissement du temps de travail à huit heures, augmentation des salaires, reconnaissance du syndicat…
Devant le refus de la direction, l’ensemble des cabanières cesse le travail à 15 heures. Toute la chaîne de production du fromage est en péril. « Victoire complète du prolétariat. Non seulement les revendications formulées sont acceptées, mais une organisation syndicale vient couronner ce premier effort d’émancipation », peut-on lire trois jours plus tard dans « l’Humanité ». Un chemin rend hommage à ces milliers de femmes qui furent essentielles dans le succès du roquefort.
Office de tourisme Pays du Roquefort, avenue de Lauras, 12250 Roquefort-sur-Soulzon ; tél. : 05 65 58 56 00. www.roquefort-tourisme.fr
Commune de départ : Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron). Type de balade : randonnée pédestre. Difficulté : moyenne. Durée : 3 h 30. Distance : 12 km.
Les sentiers autour de Roquefort-sur-Soulzon ont été empruntés à pied par des générations de femmes venues travailler chez les fabricants de fromage depuis les hameaux ou les villages environnants. Ce chemin, reliant Roquefort et Montclarat (sur la commune de Saint-Rome-de-Cernon), est proposé par le parc naturel régional des Grands Causses
Départ de l’office de tourisme. Le sentier descend dans la vallée du Soulzon.
Après la source de Montclarat, le chemin monte vers le plateau.
À Montclarat, panneau sur les récits de cabanières.
Dédale rocheux de Roucangel, véritable « village de rochers » créé par l’érosion.
Le chemin suit les méandres du Soulzon et passe devant le menhir (3 m de hauteur) à l’origine incertaine.
https://rando.parc-grands-causses.fr/trek/50046-chemin-des-Cabanières
Avant de partir, une dernière chose…
Contrairement à 90% des médias français aujourd’hui, l’Humanité ne dépend ni de grands groupes ni de milliardaires. Cela signifie que :
nous vous apportons des informations impartiales, sans compromis. Mais aussi que
nous n’avons pas les moyens financiers dont bénéficient les autres médias.
L’information indépendante et de qualité a un coût. Payez-le.Je veux en savoir plus