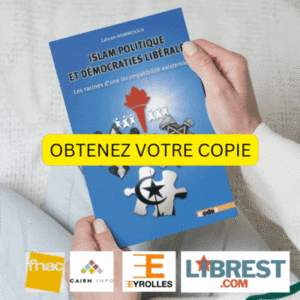« Je prends cette décision comme un coup de massue. Je suis un peu assommée. Il faut que je passe à l’action. » Il est 12h39, ce vendredi 7 février, quand l’universitaire Pinar Selek interrompt les prises de paroles de soutien organisées par la communauté académique dans le somptueux Château du parc Valrose de l’Université Côte d’Azur, à Nice. Elle vient d’apprendre le report de son procès au 25 avril prochain. « Le but, c’est de me fatiguer, explique-t-elle. De fatiguer mes soutiens. De fatiguer les journalistes. » Depuis plus de 25 ans, la sociologue turque subit l’acharnement du pouvoir, dans son pays, pour ses recherches en sociologie sur les minorités, dont notamment les Kurdes et les femmes.
« Pinar a été arrêtée en 1998 pour un attentat qu’elle n’a pas commis et, qui plus est, n’a jamais eu lieu », rappelle l’anthropologue, directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Michel Agier. Son image est projetée sur l’immense écran du théâtre où sont réunis plusieurs dizaines de chercheurs et de responsables d’institutions universitaires (CNRS, IRD, …) mobilisés, en ce jour de procès. « Elle a été torturée pour avoir protégé l’identité des témoins rencontrés sur le terrain de ses recherches concernant la minorité kurde. C’est pourtant un des fondements de la liberté académique », développe-t-il. Il rappelle aussi que jusque-là, les verdicts d’au moins quatre procès intentés par Ankara contre Pinar Selek ont débouché sur un acquittement.
La chercheuse a obtenu la nationalité française en 2017, après un statut de réfugiée, délivré à son arrivée en France, en 2011. Elle a toutefois été condamnée à la prison à vie par la Cour suprême turque, en juin 2022. « Veulent-ils en finir avec moi par le silence, comme le régime iranien s’apprête à le faire pour ces deux femmes ? », questionne Pinar selek, en brandissant les portraits de Verisheh Moradi et Pakhshan Azizi, deux féministes kurdes, dont la condamnation à mort par Téhéran a été confirmée la veille. « J’ai décidé d’envoyer à ces lucioles un cadeau, déclare la chercheuse, avant de se mettre en route pour la poste la plus proche. Je vais leur adresser un colis à la prison d’Evin, en Iran, où elles sont retenues. J’y place la médaille des droits humains dont vient de m’honorer la ville de Grenoble, des gants, des chaussettes, un mot de ma main et un dessin qu’Edmond Baudoin a réalisé pour me soutenir. Je sais que ce colis ne leur sera pas remis. Mais je sais aussi qu’elles seront informées de mon geste grâce à vous, les journalistes et vous tous qui êtes là aujourd’hui. » Et de scander, une fois devant le bureau de poste : « Jin, Jiyan, Azadî ! » (Femme, vie, liberté en langue kurde – ndlr).
La communauté scientifique qui applaudi à son courage a, elle-même, été directement incriminée par le pouvoir turc. Lors de la dernière audience du procès de Pinar Selek, en juin 2024, l’accusation a qualifié un séminaire de l’Unité de Recherches Migrations et Société, le laboratoire du CNRS dont est membre la chercheuse, d’ « acte terroriste. » Une délégation de chercheurs du CNRS et de l’IRD a récemment été reçue au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour exiger un soutien de l’État français face à cette attaque contre la liberté académique.
« Je dois maintenant renforcer ma joie, car le pouvoir, pour dominer, a besoin de corps tristes », déclare alors Pinar Selek, avant de quitter ses pairs pour rejoindre, en fin d’après-midi, le tissu associatif et culturel niçois, réuni à la Maison des associations. Sur place, des représentants de la Ligue des droits de l’homme, du Syndicat des avocats de France (SAF) ; ou encore du Planning familial enchaînent les prises de paroles en soutien à la sociologue. Un temps de visioconférence est également organisé pour échanger avec la quarantaine de personnes, originaires de France, de Belgique et de Suisse, présentes à Istanbul pour son procès. Des avocats, des parlementaires européens, des responsables associatifs, s’y sont réunis pour dénoncer cet énième coup bas de la justice turque.
Ces soutiens permettent à la scientifique franco turque de tenir debout et, ils l’espèrent, de bientôt mener à bout ses projets de recherche, comme celui qu’elle a annoncé à l’été 2024 : « Vous lirez bientôt ma parole sur ma recherche confisquée et qui saigne en moi depuis 26 ans », avait-elle alors déclaré. Elle avait ensuite cité un extrait de préface de son livre à venir : « Ma recherche était un organisme vivant. Elle était née et elle a continué à grandir. Elle a été juste enlevée mais pas avorté. La naissance n’est pas la publication. Ces matériaux sont blessés mais toujours en vie, en transformation, en vibration. Pour les soigner, j’écris ».
Emilia Urbach