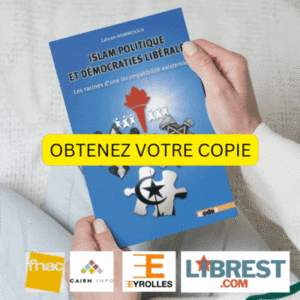Le député de Mayenne Guillaume Garot, porteur de la proposition de loi transpartisane sur la régulation de l’installation des médecins, qui reviendra devant l’Assemblée nationale début mai, a sillonné l’Occitanie, ce mercredi 9 avril. Ici aussi, on cherche une solution au manque de médecins : le dispositif “Ma Santé, ma Région” a permis à 31 000 patients de trouver un médecin traitant, et de recruter 100 médecins, selon le premier bilan de l’opération.
Une visite du centre de santé de Saint-Hilaire de Bretmas et un passage à l’hôpital d’Alès, dans le Gard, dans la foulée d’une matinée de travail à l’Hôtel de Région de Montpellier, en présence de la doyenne de la faculté de médecine Montpellier-Nîmes, présidente de la conférence des doyens.
Isabelle Laffont, à l’image de la communauté médicale qui annonce une grève d’ampleur, à partir du 28 avril, et une manifestation à Paris, le 29 avril, est pourtant “vent debout” contre la proposition de loi dite Garot, d’initiative transpartisane, qui veut mettre fin à la liberté d’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Un serpent de mer.
Mais ce mercredi 9 avril, une semaine après le vote, historique, de l’article 1 du texte qui reviendra les 6 et 7 mai à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, l’heure était à l’apaisement. “J’ai proposé à Guillaume (Garot, député de Mayenne) d’allier nos forces, sur un sujet de préoccupation majeur, que l’on soit en Occitanie, en Bretagne, en Mayenne ou à Mayotte, la question du rendez-vous chez le médecin est constante, et angoissante, chez nos concitoyens”, lance la présidente de la Région.
Les chiffres nationaux sont connus : 8 millions de Français (87 % du territoire) vivent dans un désert médical, ils sont 6 millions à ne pas avoir de médecin traitant, 1,6 million à renoncer chaque année à des soins. En Lozère, département emblématique de la problématique, plus de 10 % des habitants n’ont pas de référent, il ne reste que 51 généralistes, 65 médecins pour 100 000 habitants, contre 82 en France. Et un seul cardiologue, un pneumologue, trois gynécologues.
Le député de Mayenne a passé la journée à sillonner une “région exemplaire qui déploie une politique volontariste et efficace” contre les déserts médicaux.
La santé, hors des compétences des Régions
“Salarier des médecins”, la mesure phare du “Ma santé, ma Région” a permis de recruter 100 médecins (et quatre sages-femmes, 41 secrétaires et assistants médicaux), la moitié de l’objectif, dans des centres de santé dédiés, intégrés dans un GIP (groupement d’intérêt public). Il en existe 22 en Occitanie, cinq ouvertures sont programmées en 2025 et 31 000 patients ont pu accéder à un médecin traitant, liste Carole Delga, qui s’est engouffrée dans un “flou juridique”, “la santé n’est pas une compétence des régions”.
Ma santé, ma Région, le bilan
Outre le recrutement de médecins salariés, le dispositif “Ma santé, ma Région” prend trois autres engagements, certains dans la continuité d’engagements précédents, comme la création et la rénovation de 143 maisons de santé, “pour soutenir les médecins libéraux dans les territoires”. Avec les centres de santé (pour les médecins salariés), ces engagements ont mobilisé 15 millions d’euros.
La Région rappelle qu’elle investit aussi pour soutenir l’hôpital public : 52 millions d’euros pour reconstruire et équiper des hôpitaux, en appui du Ségur de la santé, 30 millions de fonds européens affectés aux services d’urgences, et, pour la principale nouveauté, création de vingt postes de médecins spécialistes financés dans les hôpitaux de proximité, dans un cadre encore différent du salariat : la Région prend en charge 50 % du coût de la part universitaire du poste, à parité avec l’ARS. Un ophtalmologue, un gastro-entérologue et un hépatologue-addictologue sont arrivés à l’hôpital de Sète, un urgentiste à l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze et à celui de Narbonne, des gériatre, urologue, gynécologues, spécialiste de médecine interne à Alès… l’expérimentation durera deux ans. Ils ont trois missions : soin, formation, recherche.
Enfin, des “options santé”, première marche d’une entrée dans des études de santé, ont déjà été créées dans 13 lycées, quatre autres suivront à la rentrée 2025, pour contourner le “décrochage” observé dans les ambitions des jeunes, entre “les plus modestes et les milieux favorisés”, insiste Carole Delga. “Ce sont les fils de médecins qui font médecine”, traduit Vincent Bounes.
“Oui, ça marche”, s’enthousiasme l’urgentiste Vincent Bounes, conseiller régional chargé de la santé et des déserts médicaux.
Au Vigan, à Lussan, Jonquière Saint-Vincent, Lodève, Bize-Minervois, Durban-Corbières, Amélie les Bain, Céret… des postes restent à pouvoir, sur un contrat défini d’entrée : il faut assurer des visites à domicile, garder des créneaux pour les urgences, participer à la permanence de soins, “une garde par mois, un week-end tous les six mois”.
“Les mentalités ont changé”
“L’obligation” de permanence des soins, c’est aussi un des objectifs de la loi Garot, un des trois articles “tout aussi importants et complémentaires” qui seront soumis aux députés en mai : “Aujourd’hui, quatre médecins sur dix assurent cette permanence, sur la base du volontariat. Il faut mieux répartir les efforts pour qu’ils soient supportables, et c’est ce qu’ils demandent eux-mêmes”, assure le député, convaincu que sa proposition de loi a sa chance, “avec des compromis”, malgré plus de vingt ans de tentatives échouées de régulation, et l’hostilité affichée de Yannick Neuder, ministre de la Santé.
“Yannick Neuder s’est exprimé il y a dix jours en faveur de l’obligation d’installation… Aujourd’hui, les mentalités ont changé. L’obligation n’est pas la solution magique contre les déserts médicaux, mais c’est un levier d’action indispensable pour que toutes les autres incitations fonctionnent”, reprend Guillaume Garot, persuadé qu’on “n’a pas tout essayé contre les déserts médicaux”.
Le député PS déroule un discours politique rodé : “L’accès aux soins est un des piliers du pacte républicain, il faut impérativement retisser le lien, car ce sentiment d’abandon, d’injustice profond, est délétère pour la République. Nous sommes regardés par les Français qui attendent un médecin”.
Il redit aux médecins : “N’allez pas vous installer où vos confrères sont suffisamment nombreux. Allez là où vos patients vous attendent. La loi n’est pas contre vous, ce que j’entends trop souvent, elle est contre les déserts médicaux”. Et à Carole Delga : “Face aux déserts médicaux, nous devons avancer coudes serrés. J’espère que la politique menée ici inspirera d’autres régions, et l’exemple de l’Occitanie montre qu’il est possible d’agir.”

Killian L’helgouarc’h, président national des internes : “La régulation est une fausse bonne idée”
Killian L’helgouarc’h, interne en médecine générale, est étudiant à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes.
Comment réagissez-vous à la perspective d’un encadrement des installations des médecins ?
On fera une conférence de presse le 16 avril prochain, commune à tous les syndicats seniors et juniors de médecin, c’est historique.Et on appelle à une grève à partir du 28 avril. Des manifestations sont prévues le 29 avril à Paris et en Province. L’objectif est de faire un mouvement d’ampleur qui démontre aux députés que cette solution que monsieur Garot appelle de ses vœux comme une solution “miracle” pour l’accès aux soins ne sera que de la poudre aux yeux, et ne changera rien. Les internes sont très mobilisés.
N’est-il pas temps, pour les médecins, d’accepter la contrainte compte tenu des problèmes de déserts médicaux ?
On prend souvent l’exemple des chirurgiens dentistes… mais ils ont connu une explosion démographique de l’installation en libéral. Ce n’est absolument pas ce que nous, nous allons connaître dans les prochaines années. Il va y avoir une augmentation jusqu’en 2030 pour la médecine générale, puis une stagnation. Ce que M. Garot n’est pas adapté parce qu’on n’est pas assez nombreux. On ne résout pas une pénurie en régulant une pénurie. Et la population augmente.
La régulation à l’installation est une fausse bonne idée. Les maires et les Conseils départementaux le disent aussi.
En revanche, on porte d’autres mesures.
C’est-à-dire ?
L’assistanat territorial est une mesure qui, si elle était mise en place aujourd’hui, permettrait de mettre entre 2000 et 4000 médecins dans les territoires.
De quoi s’agit-il ?
À l’issue de l’internat, un interne peut aujourd’hui décider d’être assistant des hôpitaux. Il fait un ou deux ans dans les hôpitaux publics, avant d’avoir un poste de praticien hospitalier ou de partir dans le monde libéral.
On créerait, avec les ARS, des postes attractifs, fléchés dans les territoires, à l’hôpital et en libéral. Ce serait sur la base du volontariat, mais je n’ai aucun doute sur le succès.
Ce serait une mesure de court terme., il faut arrêter de déraciner les étudiants de leur bassin de vie, aller chercher les étudiants de tous les territoires, et aider les jeunes de territoires les plus éloignés des facultés de médecine à penser que la médecine, c’est aussi fait pour eux, et il y a un enjeu de faire des stages dans des territoires sous-denses sur l’ensemble du cursus.
Qu’est-ce qui est si différent de la proposition de loi ?
Dans la proposition de M. Garot, il n’y a plus de possibilité d’installation de médecin généraliste sur 13 % du territoire, c’est-à-dire à Toulouse, Montpellier, ou Nîmes. On manque de médecins partout, et je rappelle qu’en 2023, sur les 2000 nouveaux installés en médecine générale, 400 seulement se sont installés en zone sur-dense.
Dans une France très fracturée, cette réforme, qui se fait sans nous, n’est pas une bonne solution. Je n’ai pas cessé d’alerter les députés de gauche pour échanger avec eux sur les solutions que nous pouvions mettre en place. Je n’ai jamais eu de retour. On voit quotidiennement la souffrance des patients, on les entend tous les jours, on veut, nous aussi, améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.