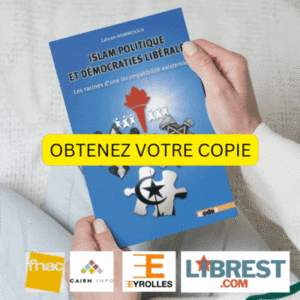Cédric Durand, chercheur en économie à l’université de Genève, a trouvé le mot de technoféodalisme dans Cyberpunk. Ce jeu de rôle de la fin des années 1980, issu d’un genre de la SF né en 1984 sous la plume de William Gibson, met en scène un futur proche dystopique où le monde est dirigé par des mégacorporations et où le pouvoir politique a été digéré par le capitalisme. S’il publie le livre Technoféodalisme : critique de l’économie numérique (la Découverte) en 2020, l’état du monde de 2025 rend son ouvrage encore plus pertinent. Ces entreprises sont les invitées d’honneur du forum mondial sur l’IA.
Quelles sont les grandes caractéristiques économiques du féodalisme que vous développez ?
Je ne parle pas d’un féodalisme en historien, plutôt de manière analytique. La notion principale que j’en tire est une fusion du pouvoir politique et de l’économique. C’est le pouvoir sur la terre et sur les hommes des seigneurs féodaux.
J’ajouterais qu’il y a une dépendance des humains à la terre, à la glèbe. Ils ne sont pas libres de travailler où ils le veulent. La soumission politique va de pair avec la soumission économique. Enfin, on constate une forme de stagnation. Il n’y a pas de recombinaison des forces productives. Le seigneur réinvestit ses profits, ses gains pour conforter son pouvoir politique : faire la guerre, organiser des fêtes…
Le technofodalisme fonctionne-t-il de la même manière ?
Principalement oui. La différence avec le féodalisme, c’est que, dans ce dernier, le travail est organisé à échelle individuelle. Alors qu’aujourd’hui la sociabilisation du travail grâce aux plateformes s’effectue à l’échelle planétaire. Sinon, on retrouve la fusion du politique et de l’économique : lorsque Elon Musk rentre à la Maison-Blanche et prend en charge la réorganisation de l’État, c’est vraiment une réalisation de ce devenir technoféodal.
La dépendance est aussi généralisée : on ne peut pas se passer de toutes les big tech. Individuellement, mais dans notre rapport aux administrations, l’éducation nationale est en contrat avec Microsoft, la SNCF est hébergée par Amazon… Cela entraîne aussi un mouvement de centralisation de la valeur.
Où est la logique de stagnation ? Amazon et Uber ont investi pour conquérir des marchés et se mettre en situation de monopole.
Stagnation n’est pas immobilisme. Cela veut dire qu’on n’est pas dans une logique productiviste, comme dans le capitalisme classique. Il faut bien distinguer le point de vue micro – celui d’une firme – du macro : une économie nationale ou mondiale.
Les big tech accumulent et brûlent énormément d’argent. C’est vrai. Mais elles centralisent beaucoup plus de profits qu’elles n’investissent pas et tuent dans l’œuf beaucoup d’autres activités autour. En résumé, ces entreprises n’investissent pas dans des moyens de production, mais dans des moyens de prédation. Cela ne bénéficie pas à l’économie en général.
Pour filer la métaphore, les serfs d’aujourd’hui, sont-ce les travailleurs des plateformes, de la donnée ? Ou est-ce nous tous, producteurs et consommateurs de services numériques ?
Le numérique s’appuie en effet sur beaucoup de travail : coder, entraîner les algorithmes… Une organisation du travail dispersée à échelle mondiale, payée à la pièce. Comme pour les travailleurs des plateformes – comme les livreurs –, le travail est surveillé, organisé algorithmiquement. Il est d’autant moins autonome que le travailleur ne peut pas rendre ce même service hors de la plateforme.
Il y est attaché un peu comme le serf l’était à la terre. Et c’est l’une des grandes difficultés que rencontrent les coopératives qui proposent des alternatives : le mouvement d’arrachement est très difficile. Sinon, je ne suis pas très à l’aise avec l’idée qu’on serait tous des travailleurs. OK, les big tech exploitent nos données, mais en surfant sur Internet, on ne peut pas dire qu’on travaille de la même manière que quelqu’un dans un entrepôt Amazon par exemple.
Et si les seigneurs sont les géants du numérique, comment expliquez-vous le défilé des patrons des Gafam à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride ? Ne prêtaient-ils pas allégeance au nouveau président ?
Mar-a-Lago aurait des allures de Versailles ? Mais Trump n’est pas Louis XIV. L’absolutisme était un moyen de discipliner la noblesse à la faveur d’une construction de l’État. Contrairement aux apparences, ce qui se passe aux États-Unis, c’est que ce sont les big tech qui sont entrées au cœur de l’État, et non pas l’État qui soumet les big tech. Regardez les premières décisions prises : le jour de son arrivée, Trump a annulé toute régulation et supervision gouvernementale de l’IA. Il a aussi interdit la création d’une cryptomonnaie de banque centrale : le président décide d’affaiblir son État sur un sujet aussi central que la monnaie.
Elon Musk a lui pris le contrôle du département numérique de l’administration nord-américaine. Il a mis la main sur l’intégralité des données non protégées de l’État. On sait aussi que Trump veut changer le recrutement dans la fonction publique, en s’assurant de l’engagement des futurs fonctionnaires en faveur des valeurs américaines et de leur loyauté envers la branche exécutive. Les outils numériques entre les mains de Musk seront utilisés pour le vérifier. Dis autrement, l’homme le plus riche du monde est aussi à la tête d’une police politique.
Ils ont un pouvoir de contrôle et de coercition ?
Les big tech peuvent anticiper de manière efficace le comportement des individus dès lors qu’elles les observent avec régularité et précision. Une fois anticipés, il leur suffit de changer quelques paramètres pour être capable de les affecter. Nous concernant, cela sert surtout à orienter nos comportements de consommateurs. Mais il ne faut pas oublier que cela sert aussi à subordonner les administrations.
Sur quoi repose tout ce pouvoir ?
C’est la complémentarité entre plusieurs éléments qui confère aux big tech leur pouvoir. À l’origine, ce sont des sociétés différentes : Amazon est un commerçant, Google est un moteur de recherche et Tesla fabrique des voitures. Ce qu’elles ont en commun est d’abord le contrôle des infrastructures du numérique : câbles sous-marins, satellites, centres de données… Ce sont aussi des plateformes sur lesquelles les gens enregistrent leurs données.
Les Tesla sont des voitures qui filment et enregistrent en permanence ! Enfin, ces entreprises disposent toutes de services cloud et d’intelligence artificielle, avec une place de marché adossée. Ces trois éléments pris ensemble forment la glèbe numérique du technoféodalisme. Et même si demain la bulle spéculative de l’IA explose, ou qu’un acteur comme Deepseek perturbe cet ordonnancement, les big tech sont dans une situation de monopole qui me semble durable.
S’avance-t-on vers la dystopie technoféodale de Cyberpunk, avec des citoyens sous le contrôle de méga-corporations ?
Des oppositions existent. La Chine déjà est sur un autre modèle. Si une forme de fusion s’y opère aussi entre le politique et les big tech, ce n’est pas sur le même équilibre. Le parti communiste chinois garde un certain poids : par les grandes directions stratégiques, certains mécanismes financiers (l’État garde un droit de véto) et le fait que les cadres dans les grandes entreprises sont souvent aussi des cadres du parti.
Même aux États-Unis, la base sociale de ces entreprises reste étroite. Chez les proches de Trump, comme Steve Bannon, certains sont aussi opposés à ce technoféodalisme. Enfin l’extrême brutalité des propos et des ingérences de Trump et de Musk dans le débat public européen pourrait enfin pousser l’UE à réagir.
De quelle manière ?
D’abord par des mesures de protectionnisme : pour ne pas dépendre du Cloud et des algorithmes étasuniens et garantir le bon fonctionnement de nos démocraties… Il faudrait promouvoir une forme d’internationalisme numérique, avec des pays comme le Brésil, coopérer pour développer des services numériques au service des peuples et de la planète.
La souveraineté numérique n’est pas un nationalisme technologique. C’est être capable de se protéger et de développer, avec d’autres, des alternatives. Je pense aussi que les infrastructures devraient appartenir à des consortiums publics. Pour les plateformes, le modèle des communs semble le plus pertinent. Quant aux places de marchés, elles peuvent être publiques et à disposition de tous.
Le média que les milliardaires ne peuvent pas s’acheter
Nous ne sommes financés par aucun milliardaire. Et nous en sommes fiers ! Mais nous sommes confrontés à des défis financiers constants. Soutenez-nous ! Votre don sera défiscalisé : donner 5€ vous reviendra à 1.65€. Le prix d’un café.Je veux en savoir plus !