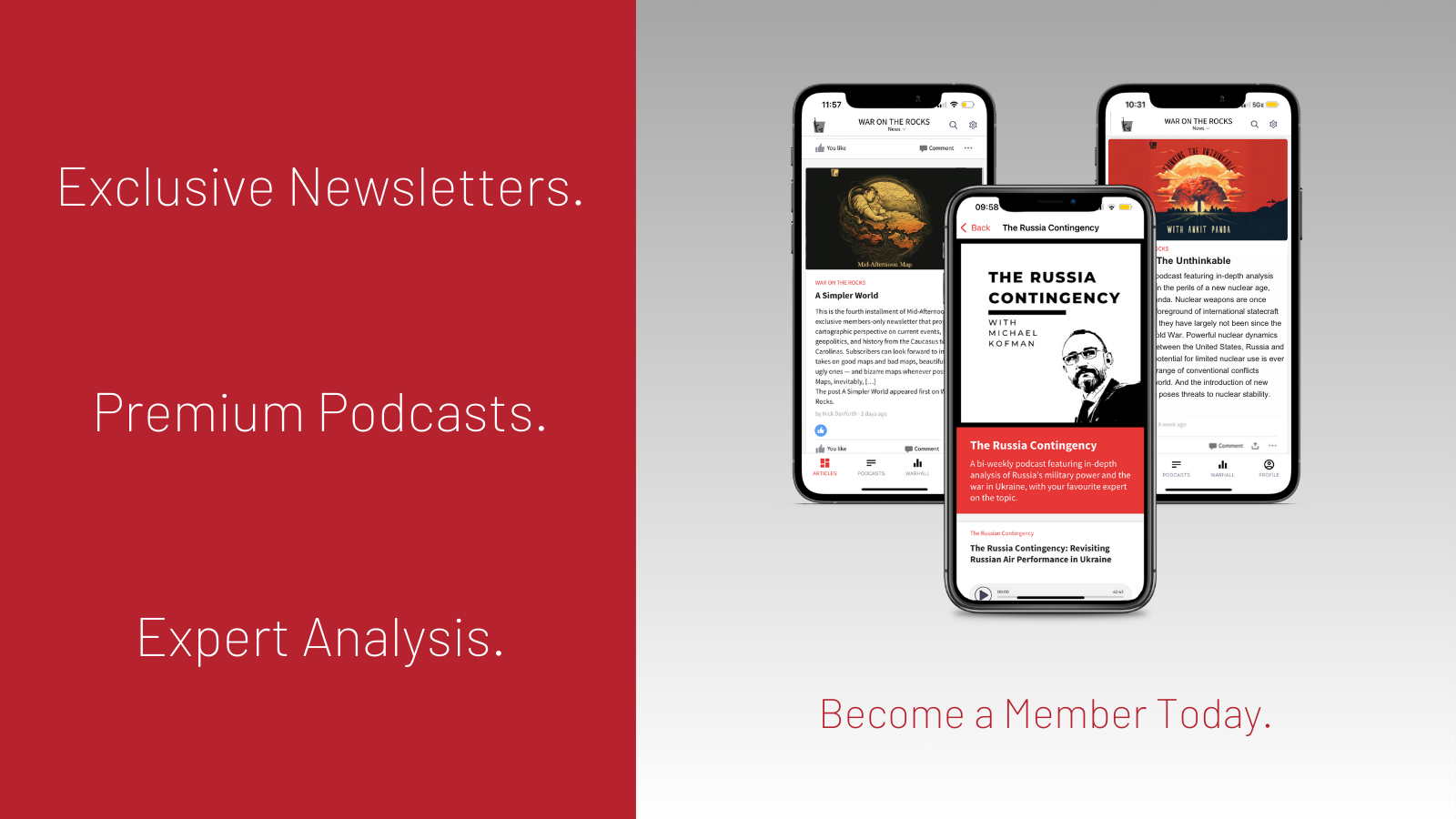Lorsqu’il s’agit de bombarder le Yémen, le Congrès semble plus intéressé à être consulté qu’au fond de cette consultation. Lorsque l’administration Biden a commencé à attaquer les positions des Houthis plus tôt cette année, des membres du Congrès de tout le spectre idéologique se sont tournés vers les médias sociaux pour dénoncer ces frappes – mais leurs critiques se sont concentrées presque entièrement sur le fait que personne n’a demandé leur permission au préalable. « Le président Biden doit venir au Congrès et nous demander d’autoriser cet acte de guerre », a tweeté la représentante Anna Paulina Luna (R-FL). « La Maison Blanche doit travailler avec le Congrès avant de poursuivre ces frappes aériennes au Yémen », a ajouté le représentant Mark Pocan (Démocrate-WI).
Ces membres ont tout à fait raison de dire que le Congrès est la branche du gouvernement chargée par la Constitution d’approuver la guerre, et non le président. Le problème est qu’il ne s’agit que du dernier exemple en date d’une concentration du Congrès sur la mauvaise question. Le débat ne devrait pas être : « Ce recours à la force a-t-il été dûment autorisé ? La conversation manquante est la suivante : « Ces bombardements devraient-ils vraiment avoir lieu ?
Bien entendu, bon nombre de ces mêmes membres considèrent les conflits de procédure et de fond comme une seule et même chose. Ils estiment que le meilleur moyen de forcer un débat et potentiellement de restreindre le recours injuste à la force est d’insister pour que les présidents se présentent au Congrès pour obtenir une autorisation. Mais il existe toujours un risque à trop se concentrer sur le processus au détriment du fond. Dans le pire des cas, cela pourrait conduire le Congrès à proposer une résolution en faveur du recours à la force au Yémen, comme autorisation ex post facto de ce que l’administration est déjà en train de faire. En effet, le sénateur Chris Murphy a indiqué lors d’une récente audience qu’il aimerait faire exactement cela, affirmant qu’« une autorisation est importante pour légaliser les opérations existantes, mais aussi pour se prémunir contre une dérive non autorisée de la mission ».
Mais les pouvoirs de guerre du Congrès ne commencent ni ne se terminent par des processus d’autorisation. Les membres du Congrès qui s’opposent au recours à la force par l’exécutif devraient le dire et utiliser leurs vastes plateformes pour faire avancer le débat de manière critique. Tous les membres devraient interroger en profondeur chaque cas de guerre en organisant des audiences, en interrogeant les témoins de l’administration et en exigeant des preuves pour les allégations sous-jacentes. Et lorsque l’exécutif est incapable de justifier de manière convaincante le recours à la force sur le fond, le Congrès devrait avoir le courage politique de l’empêcher de procéder en refusant ou en révoquant l’autorisation et le financement.
Les limites de l’autorisation rétroactive
Considérez l’impact d’une autorisation rétroactive dans le sens de ce que Murphy a suggéré. Le Congrès pourrait très bien utiliser un tel processus d’autorisation pour débattre vigoureusement de ce recours à la force sur le fond. Peut-être que, dans ce processus, ils remarqueraient que le président Joe Biden lui-même a déclaré que les frappes étaient inefficaces. Peut-être profiteraient-ils de cette occasion pour souligner que les attaques des Houthis sont clairement liées à la crise à Gaza, comme en témoignent les propres déclarations des Houthis et le fait qu’ils ont renoncé à leurs attaques pendant le court cessez-le-feu de novembre. Peut-être que cela amènerait le Congrès à adopter une autorisation strictement limitée qui imposerait des barrières strictes à l’administration, ou à refuser complètement l’autorisation. Peut-être que toutes ces choses arriveraient ! Mais même dans le meilleur des cas, une telle approche ne suffirait pas.
D’une part, les limites textuelles ne suffisent pas à elles seules à restreindre l’exécutif. L’autorisation initiale de « guerre contre le terrorisme » post-11 septembre cible explicitement les personnes impliquées dans les attentats du 11 septembre. Pourtant, les administrations successives l’ont simplement interprété comme autorisant également la force contre les « forces associées ». Ce terme n’est pas présent dans le texte mais a été invoqué pour justifier la force contre des groupes qui n’existaient même pas au moment de ces attaques survenues au cours des plus de deux décennies qui ont suivi. De même, l’autorisation de la guerre en Irak de 2002 visait de toute évidence spécifiquement à cibler le régime de Saddam Hussein. Pourtant, 20 ans plus tard, il s’avère toujours utile pour les présidents de l’invoquer lorsqu’ils ciblent les milices soutenues par l’Iran en Irak et en Syrie. Et, bien sûr, les présidents semblent trouver une énorme autorité inhérente dans leurs propres pouvoirs constitutionnels de commandant en chef au titre de l’Article II si l’autorité statutaire semble incomplète. Les limites textuelles pourraient donc être utiles, mais seulement si quelqu’un les fait respecter.
De plus, un processus d’autorisation du Congrès n’aura pas nécessairement pour effet de restreindre le recours à la force par l’exécutif. C’est certainement possible, et en fait, il existe un précédent. Le meilleur exemple est peut-être celui de 2013, lorsque l’administration Obama a annoncé son intention de bombarder le gouvernement de Bachar al Assad en Syrie, mais a ensuite fait marche arrière après que le Congrès a insisté pour voter en premier, et il est devenu clair que le vote pourrait échouer au milieu d’une forte opposition des électeurs.
Mais il y a aussi le contre-exemple de la guerre en Irak de 2003, au cours de laquelle le Congrès a eu toutes les occasions d’enquêter sur les faits et de débattre des mérites de l’invasion avant qu’elle n’ait lieu. Même au milieu d’un dossier de guerre fragile de la part de l’administration Bush et d’une vague massive de pressions populaires anti-guerre, le Congrès a facilement adopté une autorisation. Et lorsque l’administration Obama a demandé l’autorisation du Congrès pour sa campagne contre l’État islamique, qui bénéficiait d’un large soutien bipartisan mais n’était clairement pas envisagée par les autorisations existantes, le Congrès s’est trouvé incapable de s’entendre sur les détails et a refusé de s’engager. Cela n’a entraîné aucune pause dans la campagne : l’administration a simplement trouvé un moyen de faire valoir que ses autorités existantes étaient après tout suffisantes.
Enfin, il est également tout à fait possible que les faucons de l’administration ou du Congrès choisissent d’autoriser le recours à la force militaire au Congrès, sans aucune limite significative à la campagne de bombardement du Yémen et risquant d’ouvrir la voie à une autre guerre américaine futile et coûteuse au Yémen. région. À moins que les mêmes membres réclamant une autorisation n’aient également construit une coalition suffisamment grande pour voter contre une mauvaise autorisation, un tel résultat réduirait au mieux le rôle de puissance de guerre du pouvoir législatif à un simple tampon pour ce que l’administration a déjà décidé de faire de son gouvernement. propre volonté. Au pire, cela consoliderait et renforcerait ce que le Congrès cherche à restreindre.
Un précédent post-11 septembre
Cette dynamique n’est nulle part plus claire que dans le débat apparemment sans fin sur l’autorisation de la « guerre mondiale contre le terrorisme ». Bien qu’elles aient pris d’autres noms et aient largement disparu de l’attention du public, les opérations militaires américaines tentaculaires au nom de la lutte contre le terrorisme se poursuivent dans des dizaines de pays plus de deux décennies après les invasions de l’Irak et de l’Afghanistan après le 11 septembre. Il n’y a que deux autorisations du Congrès qui soutiennent ces opérations en partie ou en totalité : la résolution adoptée en 2002 autorisant la force contre l’Irak de Saddam, et le feu vert de 60 mots au recours à la force contre les responsables du 11 septembre 2001, adopté quelques jours seulement après. ces attaques.
Ces autorisations vieillissantes sont clairement inappropriées au moment présent et ont nécessité un sain mélange de jurisme créatif et d’illusion pour argumenter le contraire au fil des années. Sur une base bipartite, une longue succession de présidents, de membres du Congrès et de défenseurs de la société civile semblent être d’accord sur ce fait depuis plus d’une décennie. Des audiences ont eu lieu, des lois ont été présentées et de l’encre a coulé sur les pages d’articles d’opinion. Pas plus tard que l’année dernière, un groupe de travail bipartite au Congrès s’est engagé à enfin aborder la question.
Mais prenez bien note de la concentration de l’énergie dans ces efforts. Les querelles internes semblent porter entièrement sur des questions telles que les groupes armés visés par l’autorisation, la question de savoir s’il doit y avoir des limites géographiques pour le recours à la force, si les troupes terrestres doivent être impliquées et quand l’autorisation doit expirer, le cas échéant. Ce sont exactement les mêmes contours de débats qui durent depuis plus d’une décennie. Divers membres du Congrès ont proposé des autorisations actualisées qui s’embourbent dans cette même spirale de débats avant de finalement n’aboutir à rien.
Comme l’a déclaré l’un des principaux négociateurs à propos des efforts des groupes de travail : « Il ne s’agit pas d’un sujet soulevé par des individus opposés à la guerre ou au recours à la force militaire. Il s’agit d’une question constitutionnelle dont beaucoup d’entre nous estiment qu’elle a été abusée pendant longtemps. » C’est un aveu honnête : toute la conversation qui se déroule dans l’espace politique de Washington vise à garantir que les efforts antiterroristes mondiaux en cours soient soutenus par les documents appropriés, au lieu d’aborder la question difficile de savoir si de telles opérations devraient même avoir lieu.
Il est en fait stupéfiant de constater à quel point ce débat est absent des couloirs du Congrès. Après plus de 20 ans, plus de 8 000 milliards de dollars et des centaines de milliers, voire des millions de cadavres, les groupes armés se livrant au terrorisme n’ont fait que proliférer et se propager. La « lutte contre le terrorisme » a contribué à ce résultat. La déstabilisation et les troubles résultant des opérations militaires américaines au nom de la lutte contre le terrorisme ont alimenté les déplacements, les violations des droits humains et la destruction. Les théories fondamentales qui sous-tendent la guerre contre le terrorisme se sont révélées inexactes à maintes reprises. Il est temps de reconnaître cette réalité et de mettre fin à cette mascarade, sans débattre des contours de la manière de la réautoriser et de l’enraciner.
Conclusion
En toute honnêteté, plusieurs membres du Congrès tentent de faire avancer le débat. Par exemple, le sénateur Tim Kaine a clairement déclaré que la violence des Houthis est liée à Gaza et qu’il n’y a aucune raison de croire que les bombardements, plutôt que de remédier à la situation à Gaza et de la désamorcer, les dissuaderont. La représentante Barbara Lee a voté seule contre l’autorisation post-11 septembre et a travaillé sans relâche pour l’abroger et mettre fin aux « guerres sans fin » qui en ont résulté.
Mais ces membres ne devraient pas être minoritaires. La seule raison pour laquelle le Congrès, et non le président, assume de si redoutables responsabilités constitutionnelles en matière de guerre n’est pas simplement pour cocher une case procédurale, mais parce qu’il est censé être difficile de recourir à l’usage de la force. La tâche n’est pas de donner à l’administration tout ce qu’elle demande, ni de se démener pour obtenir une autorisation pour ce qu’elle fait déjà. Il s’agit plutôt d’interroger de manière critique les conséquences de cette force et de déterminer si c’est la bonne ligne de conduite. Le fait de prendre de l’espace politique et du temps législatif pour se concentrer sur des processus sans substance éclipse les débats essentiels que le Congrès devrait réellement mener.
De toute évidence, il est préférable, pour des raisons de respect de la Constitution et de démocratie elle-même, que le Congrès et le public aient leur mot à dire en matière de guerre. Mais il ne suffit pas de respecter le minimum constitutionnel pour garantir une bonne politique ou restreindre le recours à la force. Il est donc grand temps pour le Congrès d’aller au-delà de la simple dénonciation des guerres non autorisées. Ce qu’il faut, c’est une branche de gouvernement véritablement égale, qui rende plus difficile la libération du pouvoir destructeur de l’armée sans un débat approfondi. Les dirigeants élus devraient aller au-delà de demander à être inclus dans ces décisions et commencer plutôt à s’opposer aux stratégies qui ont échoué sur le fond en utilisant tous les outils de leur boîte à outils législative.
Elizabeth Beavers est professeure adjointe de droit et rédactrice en politique étrangère basée à Washington, DC.
Image : photo du ministère de la Défense par Chad J. McNeeley