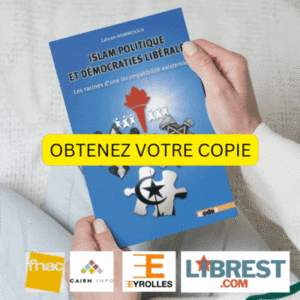Ces dernières années, les débats sur la classification de la Scientologie en tant que religion ont pris de l’ampleur, en particulier dans le contexte du droit français. L’article La Scientologie est-elle une religion ? de Frédéric-Jérôme Pansier se penche sur cette question controversée, en proposant une analyse complète fondée sur des précédents juridiques, des perspectives sociologiques et la jurisprudence internationale. Cet article journalistique synthétise les conclusions de Frédéric-Jérôme Pansier tout en intégrant des sources supplémentaires afin de fournir une compréhension plus large du sujet.
Définir la religion : une tâche complexe
Définir la religion est intrinsèquement difficile en raison de sa nature multiforme. Frédéric-Jérôme Pansier souligne que même les dictionnaires religieux omettent souvent les entrées pour « religion », se concentrant plutôt sur des doctrines ou des pratiques spécifiques. Il établit des parallèles entre la Scientologie et d’autres systèmes de croyance, notant que définir la religion implique à la fois une foi subjective et des structures communautaires objectives.
Jean Carbonnier, éminent juriste français, a identifié deux éléments essentiels pour définir la religion : un système de croyances partagé et une communauté cohésive. Ces critères s’alignent sur des définitions plus larges, telles que celle proposée par James Bissett Pratt, qui décrit la religion comme une attitude individuelle ou collective envers les forces qui influencent nos intérêts et notre destin. Paul E. Johnson a développé cette idée en mettant l’accent sur trois caractéristiques clés : les aspirations instinctives, la dépendance consciente à une puissance supérieure et les comportements visant à garantir ces valeurs (Johnson 1959).
Il est intéressant de noter que Pansier souligne que de nombreux nouveaux mouvements religieux sont confrontés au scepticisme parce qu’ils remettent en question les normes établies. Par exemple, les traditionalistes peuvent considérer les changements dans les pratiques liturgiques – comme le passage de la messe en latin aux services en langue vernaculaire – comme hérétiques. De même, l’accent mis par la Scientologie sur la découverte de soi par l’audition et la formation a rencontré une certaine résistance malgré son alignement sur des principes religieux plus larges.
Contexte historique : des sectes aux religions établies
Historiquement, le terme « secte » avait moins de connotations péjoratives qu’aujourd’hui. Dans les textes bibliques, « hairesis » désignait simplement le choix ou la préférence pour une doctrine particulière. Au fil du temps, cependant, l’Église catholique a imprégné le terme de connotations négatives, l’associant à des croyances dissidentes. Pansier note que les préjugés sociétaux influencent souvent les décisions judiciaires, ce qui conduit à des décisions incohérentes concernant les religions émergentes comme la Scientologie.
Par exemple, dans l’affaire Andreu de 1980, la Cour d’appel de Paris a reconnu le caractère religieux de la Scientologie, déclarant :
« L’Église de Scientologie semble correspondre à une activité qui s’applique à la définition habituelle donnée à la religion dès lors que… l’élément subjectif qu’est la foi est complété par un élément objectif constitué par l’existence d’une communauté humaine, si faible soit-elle, dont les membres sont unis par un système de croyance et de pratiques relatives à des choses sacrées. »
Cette reconnaissance reflète un changement par rapport aux premières décisions qui rejetaient la Scientologie comme étant un simple mouvement philosophique plutôt qu’une religion légitime.
Reconnaissance internationale de la Scientologie
Alors que la France reste prudente dans son approche, plusieurs pays ont officiellement reconnu la Scientologie comme une religion. Notamment, l’Internal Revenue Service (IRS) aux États-Unis a accordé le statut d’exonération fiscale aux organisations de Scientologie en 1993 après que des enquêtes approfondies ont confirmé leurs activités religieuses. De même, les tribunaux en Italie, en Australie et en Allemagne ont confirmé le statut religieux de la Scientologie sur la base de son cadre doctrinal et de ses pratiques communautaires.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également abordé cette question dans son arrêt de 2007 concernant l’Église de Scientologie de Moscou. La Cour a reproché aux autorités russes de ne pas avoir justifié pourquoi la Scientologie ne devait pas être considérée comme une entité religieuse au sens de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Pratiques en tant que services religieux
Les pratiques fondamentales de la Scientologie, à savoir l’audition de personnes et la formation de pratiquants, sont au cœur de sa revendication de religion. L’audition consiste en des séances guidées au cours desquelles les personnes explorent leurs traumatismes passés afin d’atteindre l’illumination spirituelle. La formation désigne les programmes éducatifs conçus pour approfondir la compréhension des principes de la Scientologie par les adeptes.
Pansier soutient que ces pratiques reflètent les rites religieux traditionnels, bien que sous des formes innovantes. Faisant des comparaisons avec la confession dans le catholicisme ou la méditation dans le bouddhisme, il affirme que l’audition a un objectif similaire : faciliter la croissance personnelle et l’éveil spirituel. En outre, la présence de chapelles dans les centres de Scientologie renforce leur rôle de lieux de culte, à l’instar des églises ou des temples dans les religions traditionnelles.
Serge Bornstein, un expert psychiatrique consulté en 1979, corrobore ce point de vue, décrivant les espaces de la Scientologie comme « des bureaux réguliers et des cérémonies (mariages, baptêmes) y sont organisés ». De telles descriptions soulignent les aspects cérémoniels qui font partie intégrante de l’identité de la Scientologie en tant que tradition religieuse.
Aspects économiques et implications juridiques
Les critiques remettent fréquemment en question les pratiques financières de la Scientologie, l’accusant d’exploiter financièrement ses membres. Cependant, Pansier réfute cet argument en faisant référence à des précédents historiques. Pendant des siècles, les religions établies ont perçu la dîme et imposé des frais pour les sacrements, des pratiques qui se poursuivent aujourd’hui. Par exemple, les funérailles catholiques impliquent souvent des coûts fixes fixés par les directives diocésaines, ce qui démontre que les transactions monétaires n’annulent pas la religiosité.
De plus, l’administration fiscale française a validé le système d’allocations de la Scientologie pour les membres permanents lors d’inspections menées en 2009 et 2011. Ces allocations, présentées comme des aides plutôt que comme des salaires, mettent l’accent sur le bénévolat plutôt que sur la dépendance économique, ce qui correspond aux exemptions accordées au clergé d’autres confessions.
Membres permanents : membres du clergé ou employés ?
Un aspect essentiel de l’analyse de Pansier concerne la question de savoir si les membres permanents de la Scientologie constituent un clergé exempté des lois du travail. Les notions traditionnelles de subordination ne s’appliquent pas ici, étant donné la structure décentralisée qui encourage l’autonomie des praticiens. Les lettres de politique du Bureau de la communication de Ron Hubbard (HCOPL) encouragent explicitement la prise de décision individuelle, décourageant les hiérarchies rigides.
Une HCOPL datée du 2 novembre 1970 déclare :
« Les actions d’une organisation peuvent toutes être classées sous la rubrique : mouvement et changement de particules. (…) Chaque poste nécessite de faire preuve de jugement et d’agir avec décision. »
De telles directives favorisent un environnement dans lequel les membres agissent de manière indépendante, guidés par des principes doctrinaux plutôt que par une supervision managériale. Par conséquent, Pansier conclut que les membres permanents fonctionnent davantage comme des ministres de la secte que comme des employés, ce qui les exempte des réglementations standard en matière d’emploi.
Conclusion : vers un plus grand pluralisme
En fin de compte, Pansier plaide pour la reconnaissance de la Scientologie en tant que religion légitime en vertu du droit français et international. En remplissant des critères tels que les systèmes de croyances communautaires, les pratiques rituelles et les codes éthiques, la Scientologie s’aligne sur les définitions acceptées de la religion. En outre, la reconnaissance de son statut favorise le pluralisme religieux, garantissant l’égalité de traitement entre les différentes traditions spirituelles.
À mesure que les sociétés mondiales évoluent, l’inclusivité devient de plus en plus essentielle. Reconnaître la Scientologie, ainsi que d’autres croyances non traditionnelles, comme des expressions valables de la spiritualité souligne l’importance de sauvegarder les libertés religieuses inscrites dans les cadres démocratiques du monde entier.
Sources supplémentaires :
- Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). (2007). Église de Scientologie de Moscou c. Russie. Requête n° 18147/02.
- Cour suprême du Royaume-Uni. (2013). R (sur la demande de Segerdal) c. le secrétaire d’État au Travail et aux Retraites. [2013] UKSC 77.
En intégrant les connaissances de diverses disciplines et juridictions, les travaux de Pansier fournissent une base solide pour réévaluer la place de la Scientologie dans le paysage religieux. Alors que les discussions sur la reconnaissance religieuse se poursuivent, il est essentiel de favoriser le dialogue et la compréhension pour parvenir à une véritable égalité et au respect de toutes les confessions.