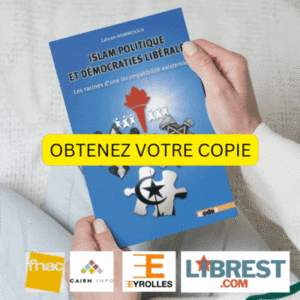Le corps médical a accueilli avec beaucoup de réserve le plan du Premier ministre destiné à lutter contre les déserts médicaux. La mesure phare – imposer jusqu’à deux jours par mois de temps de consultation aux médecins dans les territoires sous-dotés, en échange d’une compensation financière – ne convainc pas.
Sur la forme, d’abord. « Si c’est encore de la coercition, ça va mal se passer, on va aller au clash », a prévenu Sophie Bauer, présidente du Syndicat des médecins libéraux (SML), interrogée par l’AFP. « La liberté d’installation est un marqueur très fort de l’exercice libéral, en termes d’identité », corrobore Julien Mousquès, économiste de la santé, directeur de recherche à l’Institut de recherche en économie de la santé (Irdes).
« Déshabiller Paul pour habiller Jacques »
Et sur le fond, ensuite. « On est un peu surpris parce que c’est toujours raisonner comme s’il y avait beaucoup de médecins et qu’ils n’étaient pas installés là où il faut. Mais, en fait, il n’y a pas assez de médecins », a fustigé Patricia Lefébure, présidente de la Fédération des médecins de France (FMF). « Si vous déshabillez Paul pour habiller Jacques, on va jouer au jeu des chaises musicales mais tout le monde sera toujours tout nu au bout du compte », a critiqué pour sa part Agnès Giannotti, la présidente de MG France, le principal syndicat de médecins généralistes.
« On ne fait que déplacer le problème. » « Quelle pertinence de s’appuyer sur des médecins qui quitteront leur cabinet en délaissant leurs patients pour exercer dans une autre structure », s’interroge le syndicat des jeunes médecins généralistes Réagjir.
Cette mesure est également peu compatible avec un travail en équipe et pas forcément applicable à tous les médecins, notamment les spécialistes, contrairement à ce qu’affirme le gouvernement. « L’incitation financière est un élément majeur des politiques proposé ces dernières années. Mais pour l’instant, on observe que cela n’a pas modifié les choix d’installation », précise en outre Julien Mousquès.
Le corps médical massivement mobilisé
Résultat : le front de refus, allant des médecins généralistes de secteur 1 aux spécialistes installés en secteur 2, en passant par les étudiants, les internes et le Conseil de l’Ordre, est toujours d’actualité, avec un préavis de grève illimitée annoncé à partir du lundi 28 avril, suivie d’une manifestation nationale le lendemain.
Sous couvert de propositions « nouvelles », François Bayrou a tenté d’enrayer la proposition de loi Garot, dont l’article 1, adopté le 2 avril dernier à l’Assemblée contre l’avis du gouvernement, instaure une timide régulation de l’installation des médecins. Et dont la suite des discussions est prévue à partir du 5 mai, notamment sur une autre épineuse question, l’obligation de Permanence des soins ambulatoires.
Là aussi, contrairement à ce qu’avancent les syndicats frondeurs, la permanence des soins ambulatoires (PDSA) ne suffit pas à couvrir les besoins du territoire – source bilan 2023 du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM). Et par ailleurs, moins de 40 % des médecins libéraux y prennent part.
Des inégalités territoriales et financières
Sur la question du financement, en revanche, pas un mot. Que ce soit dans le plan de lutte contre les déserts médicaux du gouvernement, ou dans les propositions des syndicats de médecins. Car les inégalités d’accès aux soins sont bien sûr territoriales mais aussi financières.
On peut résider à moins de 15 minutes d’un médecin, sans qu’il soit accessible ! Les cabinets médicaux à but lucratif, portés par des chaînes commerciales appartenant à des fonds d’investissement font d’ailleurs leur beurre sur les déserts médicaux et les problèmes d’accès aux soins. Selon une enquête menée en 2024 par Ipsos pour la Fédération hospitalière de France sur les Français et l’accès aux soins, dans les 5 dernières années, 63 % des Français ont déjà renoncé à un acte médical en raison de son coût.
Comme le résumait, Christophe Prudhomme, médecin et délégué national de la CGT Santé dans l’Humanité, « la situation actuelle est la conséquence du maintien d’un système de médecine libérale qui repose sur deux principes (…) : la liberté d’installation et la rémunération à l’acte. (…) Il est évident aujourd’hui que toucher à un de ces piliers sans toucher à l’autre n’aboutira qu’à un échec. En effet, une autre cause de la difficulté d’accès aux soins réside dans les dépassements d’honoraires consubstantiels du paiement à l’acte. »
Le « paiement à l’acte », une disposition centrale
C’est un sujet technique en apparence. Mais essentiel. « Même si on constate une plus grande attraction pour des modes d’exercice différents, précise l’économiste de la santé, les médecins sont viscéralement attachés au paiement à l’acte », ce mode de rémunération qui assure 80 % des revenus des libéraux, le reste relevant de forfaits payés par l’Assurance maladie en fonction d’objectifs à remplir.
Le système convient aussi parfaitement aux pouvoirs publics : le coût d’un médecin salarié étant bien supérieur pour la collectivité. La Sécurité sociale privilégie d’ailleurs la rémunération des acteurs libéraux au détriment des centres de santé polyvalents, qui se retrouve en déficitaires structurels. « L’Assurance-maladie se rend bien compte que si elle voulait porter une politique ambitieuse basée sur une offre de soins primaires coordonnée, accessible à tous, cela serait un investissement énorme, relève l’économiste Nicolas Da Silva interrogé par le Monde. Ça l’arrange aussi de laisser les médecins se débrouiller… »
Pourtant, une étude réalisée par l’Irdes montrait notamment que les patients suivis en centres de santé consommaient moins de médicaments, étaient moins adressés aux spécialistes et avaient un nombre de consultations de suivi moindre. Donc coûtaient moins cher…
La santé, un bien commun
Les millions de personnes qui n’ont pas accès aux soins, mais aussi le déficit d’effectif de la profession et la surcharge de travail qui en découle, notamment pour les médecins généralistes, imposent de tout remettre à plat. « La seule restriction d’installation ne peut être un levier à lui seul. Les questions de conditions de travail, de rémunération, de formation doivent rentrer en ligne de compte, la réponse à apporter doit être plurifactorielle », estime Julien Mousquès. Mais en filigrane se pose la question de considérer la santé comme un bien marchand ou un bien commun. Dans l’intérêt général des pouvoirs publics et des patients.
Avant de partir, une dernière chose…
Contrairement à 90% des médias français aujourd’hui, l’Humanité ne dépend ni de grands groupes ni de milliardaires. Cela signifie que :
nous vous apportons des informations impartiales, sans compromis. Mais aussi que
nous n’avons pas les moyens financiers dont bénéficient les autres médias.
L’information indépendante et de qualité a un coût. Payez-le.Je veux en savoir plus