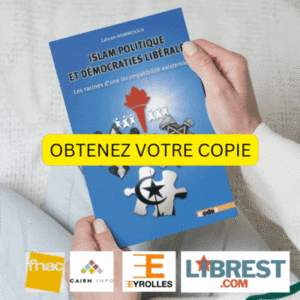Volte-face et surenchère. Donald Trump a décidé ce 9 avril d’un spectaculaire cessez-le-feu dans la guerre commerciale déclarée au monde quelques jours plus tôt, en suspendant pendant trois mois les fortes hausses des droits de douane qui devaient frapper 75 pays, dont ceux de l’Union européenne (UE). Mais au même moment, il s’est lancé dans un assaut plus terrible encore contre la Chine, qui se voit désormais affubler de tarifs douaniers accumulés de 145 %.
Ce à quoi Pékin a répliqué, vendredi 11 avril, avec des surtaxes douanières sur les produits états-unien à 125 %. « L’imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international », a déploré la Commission des droits de douane du Conseil des affaires d’État, selon un communiqué publié vendredi par le ministère des Finances. « Comme à ce niveau de tarifs, les produits américains exportés vers la Chine n’ont plus aucune possibilité d’être acceptés sur le marché » chinois, si Washington continue d’augmenter ses droits de douane, « la Chine l’ignorera », a-t-elle poursuivi.
« Un mur de refinancement »
Le président des États-Unis a de son côté expliqué son rétropédalage par le souhait qu’auraient manifesté les pays concernés à négocier avec lui d’éventuelles contreparties en échange d’un maintien des droits de douane états-uniens en l’état actuel ou majorés de seulement 10 %. Il se veut bon prince, expliquant qu’il leur laisserait ainsi du temps dans l’espoir d’un accord autour d’un quelconque marchandage. Son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, croit pouvoir affirmer, sans rire, que tout ceci « est bien la stratégie » développée par le boss depuis le début. Plus sérieusement, l’extension de l’état de panique boursière et surtout un simple coup d’œil sur l’évolution du marché des bons du Trésor états-uniens permettent de comprendre les vrais ressorts de la décision de l’oligarque devenu président.
La dévalorisation accélérée des titres de la dette publique états-unienne cotés en Bourse poussait vers le haut les taux d’intérêt sur les emprunts à dix ans contractés par Washington. Ce qui ne pouvait manquer d’avoir des conséquences terribles sur le reste d’une économie où les signes de ralentissement sont déjà très présents. Une nette hausse des taux d’emprunt public, c’est en effet mécaniquement une augmentation des taux d’emprunt immobilier et de ceux de nombre d’entreprises. De quoi précipiter, à coup sûr, le pays vers la récession redoutée par nombre d’observateurs depuis quelques semaines.
Trump est « confronté à un mur de refinancement », analyse l’ex-commissaire européen Thierry Breton. Toute hausse de taux sur la dette des États-Unis, qui culmine à quelque 36 000 milliards de dollars (environ 33 000 milliards d’euros), se traduit en effet par une charge supplémentaire de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Son seul besoin de refinancement (de souscriptions de nouvelles dettes pour relayer celles qui arrivent à échéance) « atteint pour cette année la bagatelle de 9 200 milliards de dollars (8 400 milliards d’euros) », relève un économiste états-unien.
D’où le repli peu glorieux du président sur ce front. En appliquant par contre à la Chine un traitement encore plus sévère, il cherche à diviser le monde et à isoler Pékin. Il confirme en même temps que la république populaire est bien la cible stratégique essentielle de la guerre commerciale qu’il a déclenchée. Face au développement rapide de ce pays et sa capacité à concurrencer, voire à supplanter la première puissance mondiale jusque désormais dans des domaines de pointe, le pouvoir trumpiste cherche fébrilement à allumer des contre-feux. Au risque de déstabiliser à nouveau prochainement marchés et équilibres économiques internationaux.
Une exacerbation de la force
Sur le plan militaire, Trump entend transférer sur ses alliés européens de l’Otan la plus grande part de la charge financière d’un surarmement auquel il souscrit pour dominer le monde. Il espère ainsi pouvoir mieux se tourner vers l’Asie et achever un endiguement de la Chine, inscrit dans la stratégie de l’impérialisme US depuis l’ère Obama, en faisant « pivoter » sa puissance militaire de l’Europe et du Moyen-Orient vers l’Extrême-Orient.
Plutôt que cette exacerbation de la force, tout devrait porter au contraire à chercher des solutions alternatives alors même que l’humanité est menacée sur plusieurs fronts jusque dans son existence. La crise obligataire que connaissent aujourd’hui les États-Unis est « indissociablement celle du dollar et de ses privilèges », souligne l’économiste communiste Yves Dimicoli dans son article « Trump et le dollar », publié dans la revue Économie et politique (mars 2025).
Il montre combien elle met en avant le besoin « d’une vraie monnaie commune mondiale » en lieu et place du billet vert. Soit une alternative de civilisation quand les besoins de financements internationaux n’ont jamais été aussi importants non pas pour la guerre et ses engins de mort, mais « pour le développement de tous les citoyens de la planète, leurs biens communs et l’émergence de services publics dans des dimensions sans précédent », précise Yves Dimicoli.
Le dollar : poids d’une monnaie commune mondiale
Les pays dits du Sud global souffrent plus particulièrement des conséquences de la domination du dollar quand il restreint leurs objectifs d’aménagement et de développement. Ils ont commencé avec le groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à lancer des pistes d’émancipation de la tutelle du billet vert et d’émergence d’une ou de plusieurs monnaies communes alternatives.
Tout en plaidant, de façon ostentatoire, pour que le dollar baisse – ce qui rendrait les produits made in USA plus compétitifs –, Trump n’entend rien lâcher sur l’outil de domination que constitue son fonctionnement comme monnaie commune mondiale de fait. Face au Brésil, Trump voit rouge. Le pays est en effet particulièrement en pointe sur le dossier de l’émergence d’une monnaie mondiale alternative et son ex-présidente Dilma Rousseff vient d’être reconduite pour cinq ans à la tête de la Banque de développement des Brics, basée à Shanghai. Dès novembre, il a menacé – selon ce qui est devenu, depuis, une sorte de chantage atavique – le Brésil de droits de douane à 100 % si ses dirigeants continuaient de travailler à une telle option.
Rien n’est encore écrit et les contradictions restent souvent fortes au sein du groupe des Brics et entre les pays du Sud global. Il n’empêche, leur recherche traduit l’émergence d’un des défis les plus sensibles pour l’avenir multilatéral de l’humanité. Donald Trump est loin d’être sorti du dangereux fantasme qui l’amène à vouloir tout régler à l’aune de rapports de force. Il reste que les montagnes de dettes publiques et de dollars sous lesquelles croulent les États-Unis ont eu au moins le mérite de le ramener un peu à la réalité.
Avant de partir, une dernière chose…
Contrairement à 90% des médias français aujourd’hui, l’Humanité ne dépend ni de grands groupes ni de milliardaires. Cela signifie que :
nous vous apportons des informations impartiales, sans compromis. Mais aussi que
nous n’avons pas les moyens financiers dont bénéficient les autres médias.
L’information indépendante et de qualité a un coût. Payez-le.Je veux en savoir plus