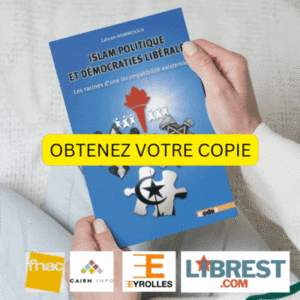Une réponse forte face à une décision jugée brutale. C’est ce qu’assurent entreprendre Emmanuel Macron et son gouvernement en appelant à une suspension des investissements français aux États-Unis par les entreprises françaises, alors que le président des États-Unis Donald Trump a dévoilé mercredi 2 avril les contours d’une politique douanière agressive. Un appel très diversement entendu par les différentes grandes marques et secteurs tricolores présents Outre-Atlantique.
Si les exportations vers les États-Unis ne représentent qu’1,5 % du PIB français, contre, par exemple, 10 % pour l’Irlande, les entreprises françaises sont en revanche bien implantées aux États-Unis, où l’Hexagone était le troisième investisseur européen et le cinquième investisseur étranger en 2023. D’après des chiffres communiqués à l’AFP par la Chambre de commerce américaine en France (AmCham), plus de 4 200 filiales d’entreprises françaises y opèrent actuellement.
« Appel au patriotisme des entreprises »
Le chef de l’État a réuni son gouvernement, les représentants patronaux et les représentants des filières industrielles à l’Élysée ce 3 avril pour aborder la riposte face à cette déclaration de guerre commerciale. En écho, ce vendredi matin, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, interrogé par BFMTV, a lui aussi fait « appel au patriotisme des entreprises » et à leur « solidarité » face à l’augmentation des droits de douanes, en attendant que des négociations parviennent, espère-t-il, à faire revenir Donald Trump dans le droit chemin. Et de préciser que les entreprises exportatrices vers les États-Unis seront « accompagnées » face à un « risque réel ».
Ces dernières devraient en effet se voir appliquer dans les prochains jours des droits de douanes à hauteur de 20 %. Certaines, sensibles aux arguments de l’exécutif, ont d’ores et déjà annoncé couper les ponts avec leurs investissements outre-atlantique. C’est le cas d’Alexandre Saubot, président de France Industrie, interrogé par Le Monde. « Il y a de toute façon trop d’incertitudes aux États-Unis pour que le pays attire les investissements. Et nous sommes tous déterminés à travailler ensemble pour ramener les Américains à la table de négociations dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré.
CMA CGM va investir 20 milliards d’euros
Interrogé sur BFMTV, le patron du Medef Patrick Martin a affirmé que ce durcissement des droits de douanes pourrait avoir des « conséquences graves à plusieurs centaines de milliers de destructions d’emploi », en particulier dans les filières de l’aéronautique et de l’agroalimentaire. Celui-ci appelle à la fermeté, et à imaginer des « mesures pour rebondir » à l’échelle de l’Europe.
D’autres champions économiques tricolores n’ont toutefois pas entendu le mot d’ordre présidentiel de la même oreille. Le patron de l’armateur CMA CGM, Rodolphe Saadé, avait ainsi immortalisé début mars, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, sa promesse d’investir 20 milliards d’euros aux États-Unis et d’y créer 10 000 emplois, alors que la menace du couperet tarifaire planait déjà.
Le constructeur automobile Stellantis, dont les marques sont un pied aux États-Unis (Chrysler, Dodge, Jeep), l’autre en Europe (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel…), promettait, quant à lui, cinq milliards d’euros à ses usines américaines. Il a depuis annoncé jeudi mettre en pause son usine Chrysler de Windsor (4 000 salariés au Canada).
Le PDG de TotalEnergies n’a pas non plus l’intention de diminuer ses investissements alors que Donald Trump a fondé sa campagne électorale sur le slogan « Drill, Baby, drill » (« fore, bébé, fore ») et que la major française envisage une double cotation, à la Bourse de Paris dans le CAC40, mais aussi à Wall Street à New York. Patrick Pouyanné pense en revanche que le « pragmatisme » conduirait l’administration de Trump à faire marche arrière sur ces droits de douane.
L’agroalimentaire sur plusieurs fronts
Du côté des services, Sodexo ne compte pas s’arrêter d’investir chez l’Oncle Sam. « Aux États-Unis, on est américains, donc on va continuer à développer nos activités » dans le pays, a estimé la présidente du groupe, Sophie Bellon. Rappelant que le pays était « le premier marché mondial de nos activités », elle a ajouté : « On n’est pas dans une industrie où on se pose la question ”est-ce qu’on va ouvrir une nouvelle usine aux États-Unis ?”».
Même double présence de chaque côté de l’Atlantique pour les géants laitiers. Danone, Savencia, Bel et Lactalis détiennent tous des sites de production aux États-Unis. Mais ceux-ci ne pourront remplacer les produits liés à des territoires (AOP) qui, eux, sont frappés par l’augmentation des droits de douane. Dans cette filière, c’est à une autre forme de solidarité qu’appellent ses acteurs.
Une « solidarité entre les filières concernées » en France et « une réponse cohérente, unie à l’échelle de l’Europe », estime le président des coopératives. Car si le marché nord-américain se tarit, d’autres alertes retentissent ailleurs. « C’est la multiplication des fronts au niveau du commerce mondial qui nous inquiète », a signalé à l’AFP François-Xavier Huard, le président de la Fédération nationale de l’industrie laitière, citant l’enquête de Pékin sur les produits laitiers et la baisse des exportations vers l’Algérie.
Incompréhension en Outre-Mer
Dans les départements, régions (DROM) ou collectivités d’outre-mer (COM) français, c’est toujours l’incompréhension depuis que Washington a décidé d’appliquer des taux différents que ceux frappant l’Union européenne, sans logique apparente faute de critères clairement établis et communiqués. Saint-Pierre-et-Miquelon se voit ainsi taxer à 50 %, La Réunion à 37 %, la Polynésie à 10 %, au lieu de 20 % sur le Vieux continent.
« Le moins qu’on puisse dire, c’est que les outre-mer ne sont pas des puissances commerciales », tranche auprès de l’AFP Ivan Odonnat, directeur général de l’Iedom-Ieom, la banque centrale des territoires ultramarins français. À l’exception de la Nouvelle-Calédonie, qui exporte du nickel mais vers l’Asie, la quasi-totalité des territoires présentent un déficit commercial massif. À La Réunion, les exportations de biens atteignaient en 2022 environ 320 millions d’euros, contre sept milliards d’euros d’importations annuelles, selon Ivan Odonnat.
Les taux de couverture – le rapport entre exportations et importations – sont très faibles : entre 5 % et 15 %, contre environ 90 % pour la France. « Ce sont des territoires qui n’existent nulle part sur la carte du commerce international », insiste le directeur général de l’Iedom-Ieom.
En Polynésie française, l’inquiétude est grande en raison des exportations de poisson vers l’Amérique (près de 1 600 tonnes de thon rouge par an, soit 92 % des exports polynésiens en valeur), de perles noires, de monoï et de vanille. « Nos importateurs sont sur le qui-vive depuis l’élection de Donald Trump », affirme à l’AFP le sénateur de la Polynésie Teva Rohfritsch. Si les taux appliqués à la Polynésie restent faibles (10 %), les États-Unis représentent aussi la première clientèle étrangère pour le tourisme dans l’archipel. Or une dépréciation du dollar, le but recherché par l’administration Trump selon Ivan Odonnat, pourrait rendre les séjours en Polynésie plus coûteux pour ces visiteurs.
Avant de partir, une dernière chose…
Contrairement à 90% des médias français aujourd’hui, l’Humanité ne dépend ni de grands groupes ni de milliardaires. Cela signifie que :
nous vous apportons des informations impartiales, sans compromis. Mais aussi que
nous n’avons pas les moyens financiers dont bénéficient les autres médias.
L’information indépendante et de qualité a un coût. Payez-le.Je veux en savoir plus