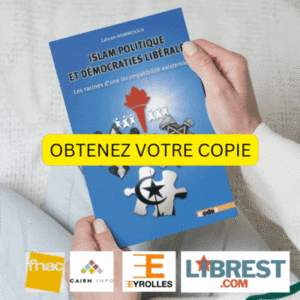Vous vous sentez tarif Whiplash? Tu n’es pas seul. Le 2 avril 2025, le président Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs – un prélèvement de 10% sur presque toutes les importations américaines, ainsi que des droits ciblés visant à punir les pays qu’il accuse d’exploiter les marchés américains. Une semaine plus tard, le 9 avril, son administration a brusquement interrompu une grande partie du plan pendant 90 jours, laissant les marchés et les alliés se précipiter pour plus de clarté.
Les tarifs proposés ont été lancés comme un moyen de relancer la fabrication américaine, de récupérer des emplois et de contrer ce que Trump considère des pratiques commerciales injustes. Mais ils ont immédiatement secoué les marchés financiers et leur ont fait des alarmes parmi les économistes et les partenaires mondiaux américains. Les critiques à travers le spectre politique ont ravivé un avertissement familier: «mendiant-thy-neighbor».
L’histoire montre que de telles politiques réussissent rarement. Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, ils sont plus susceptibles de provoquer des représailles rapides, précises et douloureuses.
Quelle est la stratégie «mendiante-thy-neighbor»?
L’expression provient de l’histoire économique et fait référence aux mesures protectionnistes – tarifs, restrictions d’importation ou manipulation des devises – conçues pour stimuler l’économie d’un pays au détriment de ses partenaires commerciaux. Pensez-y comme pour nettoyer votre cour en jetant les déchets dans la propriété de votre voisin: il vous semble bien rangé jusqu’à ce qu’ils répondent.
Cette approche contraste fortement avec les principes énoncés par Adam Smith. Dans «La richesse des nations», il a fait valoir que le commerce n’est pas un jeu à somme nulle. Spécialisation et marchés ouverts, a-t-il observé, créent un avantage mutuel – une marée montante qui soulève tous les bateaux. Les tarifs de Trump ne tiennent pas compte de cette logique.
Et l’histoire soutient Smith. Dans les années 1930, les États-Unis ont adopté une stratégie similaire à celle que Trump expérimente par le biais de la loi sur les tarifs Smoot-Hawley, augmentant les tâches pour protéger les emplois nationaux. Le résultat a été une vague de représailles mondiales qui a étouffé le commerce international et aggravé la Grande Dépression.
Un exemple: Lesotho
À titre d’exemple, considérons le tarif à 50% que les États-Unis ont imposé aux importations du Lesotho, une petite nation africaine sans littoral. La mesure est entrée en vigueur à minuit le 3 avril, mais aurait été soumise à la pause de 90 jours à partir de midi le 4 avril.
Le taux tarifaire a été calculé en prenant le déficit commercial américain avec le Lesotho – 234,5 millions de dollars américains en 2024 – divisant cela par la valeur totale des exportations du Lesotho vers les États-Unis, ou 237,3 millions de dollars, et en divisant cela par deux.
Le tarif de 50% aurait un effet négligeable sur l’économie américaine – après tout, sur les 3,3 billions de dollars que les États-Unis ont importés en 2024, seule une petite fraction provenait du Lesotho. Mais pour le Lesotho, une nation qui s’appuie fortement sur les exportations de vêtements et l’accès préférentiel sur le marché américain, les conséquences seraient graves. Utiliser la même logique tarifaire à tous les partenaires, grands ou petits, néglige les réalités économiques de base: différences d’échelle, de capacité commerciale et de vulnérabilité. Il incarne la réflexion de la mendicité de Thy-Neighbor: décharger les frustrations domestiques sur des économies plus faibles pour l’optique politique à court terme.
Le Lesotho n’est qu’un exemple. Même les pays qui importent plus des États-Unis qu’ils ne leur exportent, comme l’Australie et le Royaume-Uni, n’ont pas été épargnés. Cette mentalité de «tableau de bord» – traitant les déficits commerciaux comme des pertes et des excédents comme des victoires – les risques réduisant la complexité du commerce mondial à un jeu de tit-for-tat.

Roberta Ciuccio / AFP
Le retour d’un manuel familier – et risqué –
Une telle pensée a des conséquences. Au cours du premier mandat de Trump, la Chine a riposté contre les tarifs américains en réduisant les importations de soja américain et de porc. En conséquence, ces exportations sont passées de 14 milliards de dollars en 2017 à seulement 3 milliards de dollars en 2018, frappant les États politiquement sensibles comme l’Iowa. L’Union européenne a répondu aux tarifs américains de l’acier et de l’aluminium en menaçant de cibler le bourbon du Kentucky et des motos du Wisconsin – des produits emblématiques des États d’origine des anciens dirigeants du GOP Mitch McConnell et Paul Ryan. Le Canada et l’Union européenne ont montré une volonté d’utiliser des tactiques similaires cette fois-ci.
Ce n’est pas nouveau. En 2002, le président George W. Bush a imposé des tarifs allant jusqu’à 30% sur l’acier importé, ce qui a incité l’Union européenne à menacer des tarifs de représailles ciblant des produits tels que les agrumes de la Floride et les textiles de Caroline fabriqués dans les principaux États de swing. Face à la pression politique intérieure et à une organisation mondiale du commerce contre la mesure, Bush a inversé le cours dans les 21 mois.
Une décennie plus tôt, l’administration Clinton a enduré un différend commercial de longue date avec l’UE connu sous le nom de «Banana Wars», dans lequel les régulateurs européens ont structuré des règles d’importation qui ont désavantagé les exportateurs de bananes latino-américaines soutenues par les États-Unis en faveur d’anciennes colonies européennes.
Au cours des années d’Obama, les États-Unis ont augmenté les frais de visa qui ont eu un impact de manière disproportionnée dans le secteur des services technologiques de l’Inde. L’Inde a répondu en retardant les approbations des fabricants de médicaments américains et des investissements de détail importants.
Toutes les formes de représailles commerciales ne font pas la une des journaux. Beaucoup sont subtils, lents et bureaucratiques – mais pas moins dommageables. Les responsables des douanes peuvent retarder les documents ou peuvent imposer des exigences d’inspection ou d’étiquetage arbitraires. L’approbation des produits pharmaceutiques américains, des produits technologiques ou des produits chimiques peut être bloqué pour de vagues raisons de procédure. Les règles des marchés publics peuvent être discrètement réécrites pour exclure les entreprises américaines.
Bien que ces tactiques attirent rarement l’attention du public, leur coût cumulatif est réel: les délais de livraison manqués, les contrats perdus et la hausse des coûts opérationnels. Au fil du temps, les entreprises américaines peuvent déplacer des opérations à l’étranger – non pas en raison des coûts de main-d’œuvre ou de la réglementation à la maison, mais pour échapper à la lente goutte de punition bureaucratique qu’ils subissent ailleurs.
Tarifs dans une économie connectée
Les partisans des tarifs soutiennent souvent qu’ils protègent les industries nationales et créent des emplois. En théorie, ils pourraient. Mais dans la pratique, l’histoire récente montre qu’ils sont plus susceptibles d’inviter des représailles, d’augmenter les prix et de perturber les chaînes d’approvisionnement.
La fabrication moderne est profondément interconnectée. Un produit peut impliquer l’assemblage de composants à partir d’une douzaine de pays, se déplaçant dans les deux sens. Les tarifs blessent les fournisseurs étrangers et les fabricants, les travailleurs et les consommateurs américains.
Plus stratégiquement dommageable, ils nous érodent l’influence. Les alliés se lassent des mouvements commerciaux imprévisibles, et les rivaux, y compris la Chine et la Russie, interviennent pour forger des partenariats plus profonds. Les pays peuvent réduire leur exposition au dollar américain, vendre des obligations de trésorerie ou s’aligner sur des blocs régionaux comme le groupe BRICS – dirigé par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud – pas hors de l’idéologie, mais la nécessité.
En bref, les États-Unis affaiblissent sa propre main stratégique. Le coût à long terme n’est pas seulement économique – c’est géopolitique.
Plutôt que de recourir à des tactiques de mendiant et de soi-même, les États-Unis pourraient garantir son avenir en investissant dans ce qui motive vraiment la force à long terme: le développement de la main-d’œuvre intelligente, l’innovation révolutionnaire et les partenariats avertis avec des alliés. Cette approche aborderait les déséquilibres commerciaux grâce à une diplomatie habile au lieu de la force brute, tout en renforçant la résilience à la maison en équipant des travailleurs et des entreprises américains à prospérer – et non par des boucs émissaires.
L’histoire montre clairement: abandonner l’obsession des déficits commerciaux bilatéraux et se concentrer plutôt sur la création de valeur est payant. Les États-Unis peuvent trouver des composants du monde entier et les élever grâce à une conception, à l’innovation et à l’excellence manufacturières inégalées. C’est le rythme cardiaque de la puissance économique réelle.