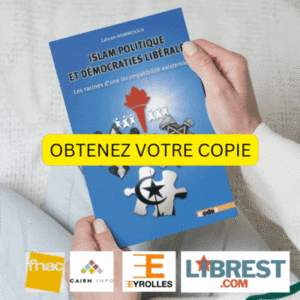Par Maryse Dumas, syndicaliste
Le syndicalisme a-t-il sa place aux deux frontières de la vie active que sont la période des études, avant l’entrée dans la vie professionnelle d’une part, celle de la retraite, après la fin de celle-ci d’autre part ? C’est la question sous-jacente à deux réunions tenues récemment. Le 23 janvier, l’Institut CGT d’histoire sociale organisait une rencontre autour du livre écrit par Frédéric Genevée et Guillaume Hoibian sur l’histoire de l’Unef entre 1971 et 2001. 1971 est l’année de la scission opérée dans l’organisation étudiante par la tendance Renouveau pour restaurer le caractère syndical de cette organisation mis à mal après mai-juin 1968. 2001, c’est l’année de la réunification des deux Unef, l’une était devenue Unef-SE (solidarité étudiante), l’autre Unef-ID (indépendance, démocratie). La deuxième réunion se tenait le 30 janvier. C’était une assemblée départementale de retraité·es de la CGT-FAPT (Poste et télécommunications).
Aussi surprenant que cela puisse paraître, des problématiques presque identiques ont été soulevées lors des deux rencontres. Par exemple, le syndicalisme a-t-il sa place dans des milieux qui ne sont pas ou qui ne sont plus salariés ? Laissons de côté le fait qu’une bonne part des étudiants ont une activité salariée pour financer leurs études et que des retraités de plus en plus nombreux poursuivent une activité plus ou moins déclarée pour parvenir à compléter leurs trop faibles pensions. Indépendamment de ces réalités, le syndicalisme a toute sa place dès lors qu’il y a des intérêts communs, des revendications collectives à défendre, et ce n’est pas ce qui manque !
La spécificité de la démarche syndicale s’affirme alors dans le rassemblement qu’elle vise (et souvent permet) de personnes aux convictions et engagements très divers, voire inexistants, mais unies par un vécu commun, un même enjeu, une même revendication. La revendication, c’est l’essence même du syndicalisme. Et on la retrouve aussi bien dans les évolutions de l’Unef que dans les échanges entre retraité·es. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui a conduit la CGT à se doter d’une organisation spécifique pour les retraité·es, afin qu’ils et elles puissent élaborer leurs propres propositions revendicatives. Celles-ci, bien qu’étant liées à la situation des actifs, notamment à leurs salaires et cotisations, ont tout de même de grandes spécificités. Les modalités d’action ne sont pas les mêmes non plus. Mais, où qu’il soit, le syndicalisme a vocation à rassembler et à représenter.
Pour faire progresser les revendications, il doit identifier les décideurs en fonction du problème posé, porter les revendications auprès d’eux et construire les rapports de forces nécessaires, pour éventuellement négocier. Chercher à « coller » aux diversités de situations et de vécus est une autre arme syndicale. Alors on crée des collectifs, des commissions, dans l’objectif à la fois de favoriser l’implication du plus grand nombre possible et de construire le collectif à partir de la prise en compte de chaque individu. Le syndicalisme est une grande école de démocratie et aussi de solidarité ! Une solidarité active qui se nourrit d’entraide, de fraternité et de luttes partagées, d’où l’importance de s’organiser dans la proximité. Un mot résume le tout : continuité syndicale. Continuité syndicale pour partager des valeurs et des pratiques émancipatrices à tous les âges de la vie, continuité syndicale pour les faire vivre dans toutes les situations.
Aux côtés de celles et ceux qui luttent !
L’urgence sociale, c’est chaque jour la priorité de l’Humanité.
En exposant la violence patronale.
En montrant ce que vivent celles et ceux qui travaillent et ceux qui aspirent à le faire.
En donnant des clés de compréhension et des outils aux salarié.es pour se défendre contre les politiques ultralibérales qui dégradent leur qualité de vie.
Vous connaissez d’autres médias qui font ça ? Soutenez-nous !Je veux en savoir plus.