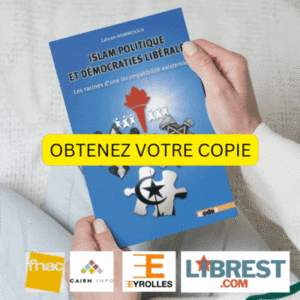Le Salon de l’agriculture qui s’ouvre ce samedi 22 février à Paris sera-t-il le dernier acte d’une année de tumulte dont le monde agricole a été le théâtre ? Alors que 600 000 personnes devraient déferler dans les allées du parc des expositions pendant dix jours, le gouvernement espère bien faire de cette grande messe de l’agriculture le témoin des engagements pris au nom des paysans en colère. Annie Genevard, ministre de l’Agriculture, compte ainsi annoncer en grande pompe l’adoption de sa loi d’orientation agricole, dont l’examen au Parlement a été sérieusement accéléré cette semaine.
Cette loi avait germé dans les dossiers du ministère à la fin de l’année 2023, alors que commençaient à fleurir les premières mobilisations de producteurs. Présentée par Gabriel Attal et votée par l’Assemblée nationale en avril 2024, la loi a pâti de la dissolution et des errances exécutives avant d’être présentée au Sénat il y a quelques semaines.
Le renouvellement générationnel des agriculteurs à la trappe
Si le texte donne des gages aux revendications de la FNSEA, des Jeunes Agriculteurs (syndicats majoritaires historiques) et de la Coordination rurale (qui s’est illustrée par une percée lors des élections aux chambres d’agriculture), il ne semble guère répondre aux problématiques les plus urgentes du monde agricole. La loi vise en effet à lever les « contraintes » qui pèsent sur la « compétitivité » de l’agriculture, en dépénalisant les atteintes au vivant et facilitant l’industrialisation des fermes.
Pour autant, les questions qui avaient allumé les braises de la colère il y a un an et demi risquent de rester sans réponse. La loi ne mentionne ainsi aucun moyen d’action pour faciliter le renouvellement des générations, alors qu’un agriculteur sur deux sera en âge de prendre sa retraite d’ici à 2030. L’enjeu du revenu, qui devrait être comme l’an dernier au cœur de cette édition, alors que les négociations commerciales entre agro-industrie et grande distribution prennent fin le 1er mars, risque lui aussi de passer à la trappe.
Il y a un an, Emmanuel Macron avait espéré « qu’on puisse déboucher » sur « des prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole », reprenant à son compte une revendication forte des syndicats progressistes. « En cette époque où un tiers des paysans vivent sous le seuil de pauvreté, que 300 suicides sont déplorés chaque année, on doit faire en sorte que chacun puisse vivre dignement de son travail. Un prix plancher, et non un prix plafond, c’est la voie indispensable », souligne ainsi Pierre Thomas, coprésident du Modef.
Ces questions, comme celle de la renégociation de la PAC (Politique agricole commune), sont d’autant plus pressantes que l’année écoulée a été rude pour les paysans, acculés par des intempéries, des épidémies et des prix d’une volatilité très forte. La récolte de 2024 a ainsi été la pire depuis plus de quarante ans. Face à cette année noire, et alors que les élections aux chambres d’agriculture n’ont en rien remis en cause l’agro-industrie et un modèle agricole tourné vers l’exportation, les autorités sauront-elles se saisir de cette occasion pour donner de vrais gages aux producteurs en difficulté ?
La Terre de nos batailles
La justice climatique, c’est notre bataille. Celle qui relie luttes environnementales et sociales pour contrer un système capitaliste faisant ventre de tout. Du vivant, de la planète, de notre humanité.
Il n’y a pas de fatalité.
Nous démasquons les manipulations des lobbies.
Nous battons en brèche les dénis climatiques mortifères.
Nous mettons en valeur les initiatives visant à réduire les inégalités environnementales et les fractures sociales.
Soutenez-nous.Je veux en savoir plus