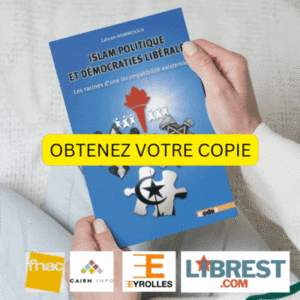Elle a été le grain de sable qui a fait dérailler la machine. Au premier rang, seule femme au milieu du groupe d’ouvriers sur le banc des parties civiles, Claudia Andrieu, dos penché vers l’avant, ne perd pas une miette de ce qui se joue ce 12 février, dernier jour d’audience devant le tribunal de Versailles, qu’elle attend depuis plus de quinze ans. Épouse de Didier Andrieu, menuisier empoisonné au plomb en 2009 avec cinq ouvriers intérimaires sur le chantier de l’Opéra royal du château de Versailles, elle a été celle qui a empêché l’enterrement programmé de ce procès, dont le verdict sera prononcé le 13 mai.
Malgré ces années d’errance judiciaire, orchestrée par la partie adverse, la juriste n’a rien lâché, déjoué les recours en série, surmonté le mur de mépris opposé à « l’épouse d’un simple ouvrier ». Le moteur de cette pugnacité ? Une foi inaltérable dans la justice et des valeurs humanistes transmises par des parents convaincus du potentiel émancipateur de l’école.
Vous avez été en première ligne pour que ce procès ait lieu. Quel a été votre état d’esprit quand il s’est enfin tenu mi-février ?
Mon état d’esprit, c’était l’espérance que justice soit faite. Qu’elle nous reconnaisse comme des victimes et donc qu’elle reconnaisse les prévenus comme des coupables, afin que ce qui est arrivé n’arrive plus jamais. Je connais les difficultés de la justice, et c’est vrai que nous y avons été confrontés pendant ce long combat. Mais, en même temps, les procès sont faits pour renforcer les droits des victimes.
Un procès ne doit jamais être une vengeance. C’est un espace où l’on doit débattre des choses essentielles. Ici, en l’occurrence, il s’agissait d’un dossier pénal, où il était question de violations de la loi, de mise en danger de la vie d’ouvriers. Le moment était enfin venu de faire le bilan de ce qui a dysfonctionné et des raisons de ces dysfonctionnements : autant les juges que la procureure étaient dans cet état d’esprit. Pour ce qui est des prévenus, en revanche, ce n’était pas le cas, puisqu’ils ont tous demandé la relaxe, s’estimant innocents des faits qu’on leur reprochait.
Avez-vous été surprise par le fait que tous les prévenus se renvoient la balle ?
Je n’ai pas été surprise par leur défense, parce que j’ai eu affaire à eux dès le moment où nous avons découvert l’empoisonnement de mon mari et de ses collègues. Je les ai contactés un par un : le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, le coordonnateur sécurité, les entreprises… Les réponses qu’ils m’ont faites étaient aussi infâmes que désespérantes. Infâmes, parce qu’ils m’ont bien fait comprendre qu’ils s’adressaient à l’épouse d’un simple ouvrier intérimaire qui n’avait à leurs yeux aucune importance. Pour la première fois de ma vie, j’ai été confrontée à un mépris de classe, déplacé et choquant.
Vous étiez-vous alors présentée comme juriste ?
Non, et je n’avais pas à le faire. Je les ai contactés en ma qualité d’épouse d’un ouvrier intérimaire empoisonné avec ses collègues sur leur chantier. Le fait que je sois juriste n’était pas le sujet à ce moment-là. Je me souviens cependant quoi le directeur du patrimoine du château de Versailles a tenu, au cours de notre premier échange, à savoir qui j’étais, sans doute parce que mes réponses lui laissaient supposer que je n’étais pas que l’épouse d’un ouvrier.
Je ne m’en suis toutefois pas prévalue à ce moment-là, parce que les autres ouvriers n’étaient, eux, pas accompagnés de la même sorte dans leur vie personnelle. Le fait que je sois juriste a revêtu par la suite une importance tout autre. J’ai pris en main les choses et ma profession m’a en effet considérablement aidée.
Votre rôle incontournable a été reconnu pendant le procès. Qu’est-ce qui vous a alertée au départ ? Pensez-vous que, sans vous, l’affaire aurait pu passer à la trappe ?
Je pense en effet que l’affaire aurait pu être étouffée. Cela faisait des années que mon mari travaillait pour la société Asselin, via une agence d’intérim, une société de menuiserie dédiée à la rénovation des monuments historiques. En 2009, pendant qu’il travaillait sur le chantier du château de Versailles, je me suis aperçue qu’il était devenu soudain très fatigué, et se plaignait de maux de ventre insupportables. Je ne le reconnaissais plus.
J’ai alors pris rendez-vous chez notre médecin. Au moment où il rédigeait la prescription de prise de sang, mon mari lui a demandé de rajouter le plomb. Douze jours plus tard, à 21 h 30, notre médecin nous a appelés. J’ai décroché et il m’a alors expliqué que mon mari était fortement empoisonné au plomb, ajoutant que c’était grave et qu’il fallait absolument prévenir son employeur et la médecine du travail, ainsi que ses collègues.
Comment vous êtes-vous alors saisie de l’affaire ?
Dès le lendemain matin, j’ai pris attache avec la médecine du travail, ce qui lui a permis de déclencher l’alerte auprès des autres ouvriers concernés. Comme mon mari, ils ont été envoyés dans un centre antipoison pour y être traités immédiatement. Nous avons alors commencé à prendre la mesure des choses.
Parallèlement, j’ai pris connaissance de l’arsenal juridique en matière de contamination au plomb des ouvriers. J’ai également contacté l’inspection du travail de Versailles, qui a été remarquable, prenant aussitôt la mesure du problème. Dans le même temps, j’ai appelé toutes les parties prenantes pour exiger des explications ainsi que les diagnostics plomb, obligatoires en amont des travaux. Je les attends toujours. Nous avons alors porté plainte.
J’ai toujours tenu les ouvriers au courant de l’évolution du dossier. Il y avait une vraie solidarité entre les parties civiles. Quand on subit une même épreuve, cela crée des liens de famille. Ce dont nous avions le plus besoin, c’était d’humanité. Nous étions soudés, le procès en a témoigné, puisque nous avons passé ces trois journées serrés les uns contre les autres. Si l’un d’entre nous flanchait, nous étions là pour passer un bras autour de ses épaules et l’aider à se relever.
Vous vous êtes également portée partie civile aux côtés de votre époux. Pourquoi ?
Parce que les conséquences, nous avons été deux à les subir. Je n’ai certes pas été intoxiquée au plomb, mais j’ai vécu tout le reste aux côtés de mon mari. Toute cette souffrance, nous l’avons vécue à deux. La peur de ce qui pouvait arriver à mon mari, ses crises d’angoisse, de colère, son sentiment d’injustice. Je ne compare pas ma souffrance à celle des ouvriers, mais moi aussi j’ai eu peur pour la vie de mon mari. Cela a été très dur psychologiquement.
Les problèmes ne s’arrêtent pas à la porte des maisons, c’est comme un bagage que vous faites entrer chaque soir chez vous. Il a fallu beaucoup parler avec lui, même si parfois j’ai pu me sentir désarmée pour justifier les atermoiements judiciaires, les réactions de mépris.
Dans son réquisitoire, la procureure de la République met en cause une « faillite collective », tout en soulignant la responsabilité plus importante de l’employeur. Partagez-vous cette vision ?
Elle a raison, d’un côté. Tout a dysfonctionné d’une manière gravissime. On avait l’impression d’être au pays des Pieds nickelés. Le procès a confirmé qu’il n’y avait pas de capitaine dans le bateau, car il y a eu une somme d’incompétences effrayantes, ajoutées au fait que les ouvriers étaient à leurs yeux quantité négligeable. L’architecte en chef du Château et maître d’œuvre ne s’en n’est pas caché, déclarant ainsi au service en charge de l’enquête que, « compte tenu de l’étendue du chantier, la question du plomb était secondaire ». Il y a des mots qui font très mal.
Mais il faut quand même dire que, dans l’échelle des responsabilités, la loi place le maître d’ouvrage au cœur du système ; c’est lui le premier responsable, parce que c’est lui qui passe la commande, qui paie, qui maîtrise les budgets. Il est donc au cœur de ce système qui a failli.
Cette loi a été articulée de telle sorte que si l’un des maillons de la chaîne vient à dysfonctionner, les autres ne puissent pas suivre le même chemin et donnent l’alerte. Cette législation impose ce qu’on appelle une obligation de résultat. Or, le moins que l’on puisse dire est que tous les garde-fous ont sauté dans cette affaire.
Il y a un télescopage frappant entre la symbolique du château de Versailles et la façon dont les ouvriers y ont été traités…
Oui, cette confrontation entre l’imaginaire existant autour de ce château et le sort fait à des ouvriers précaires est édifiante. Mais, au-delà du cadre, il y a d’abord la responsabilité des hommes. Il y a, parmi les personnes qui gravitent autour du château de Versailles, des gens qui se considèrent comme une élite, parce qu’ils ont pu faire de grandes études. Force est de constater que cela ne leur a rien appris de l’humanité. Le problème est qu’ils en sont venus à croire qu’ils sont eux aussi des rois, et qu’ils sont intouchables. Or, même les petits rois ne peuvent empêcher la justice de passer.
Ces gens si fiers d’eux-mêmes devraient l’être, à mon sens, beaucoup moins face à ce qui s’est passé. Cette faillite collective s’est abattue sur tout ce qui aurait dû protéger les ouvriers et leurs familles. Il faut signaler que ces travailleurs sont rentrés chez eux avec des vêtements imprégnés de poussière de plomb et que les déchets de ce chantier ont été évacués avec les déchets ménagers. Ce qui laisse penser qu’il y a eu aussi beaucoup de victimes invisibles.
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’entreprise Asselin embauchait des intérimaires sur ces chantiers-là : des ouvriers non organisés, non protégés, complètement vulnérables. En fait, pour ces responsables, la vie humaine n’a que peu d’importance au regard des intérêts financiers.
Est-ce que ces seize années de combat vous ont transformée ?
Oui, je le pense. Je suis depuis trente ans juriste dans le domaine de la propriété intellectuelle, au sein de la succession Picasso. Avec cette affaire, j’ai dû me confronter à un droit que je ne connaissais pas et j’ai découvert la violence terrible de ce droit-là, qui est fait normalement pour protéger des ouvriers. Or, ce qui apparaît, c’est qu’ils ont été considérablement broyés et que leur statut de victime leur a été contesté.
Mon mari a quand même fait l’objet de subornation de témoin, pour vous donner une idée de cette violence. J’ai pu voir à quel point l’homme pouvait être déshumanisé. Quand de hauts responsables en viennent à ne plus considérer l’humain, ils cessent eux-mêmes de l’être.
Qu’est-ce qui vous a permis de tenir pendant ces seize années ?
Ce qui m’a aidée, c’est le fait que je sois juriste et que je croie dans la justice. Je ne pouvais pas accepter l’idée que toutes ces personnes et ces organismes puissent ne pas répondre de leurs actes. L’un des ressorts de cette ténacité est également lié à mon histoire familiale. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont transmis des valeurs solides d’humanité, de solidarité. Je suis née en Algérie, dans un milieu modeste et une famille « pied-noir ». Mon père travaillait dans un moulin. Avec les événements de 1962 (indépendance de l’Algérie – NDLR), nous avons dû partir précipitamment. Mon père venait de passer le concours des douanes ; il a été muté au Pays basque. Partis avec deux valises, mes parents ont dû reconstruire leur vie à 40 ans. Rien n’a été facile pour eux. Ils me disaient toujours : « Étudie, étudie. » Ces mots, qui résonnent avec une chanson de Jean-Jacques Goldman (rires), m’ont toujours accompagnée. Je pense que ce sont ces valeurs-là qui ont fait de moi une combattante. Le combat et le sens de la justice sont restés, dès lors, littéralement chevillés à mon corps.
Le journal des intelligences libres
« C’est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. »Tel était « Notre but », comme l’écrivait Jean Jaurès dans le premier éditorial de l’Humanité.120 ans plus tard, il n’a pas changé. Grâce à vous. Soutenez-nous ! Votre don sera défiscalisé : donner 5€ vous reviendra à 1.65€. Le prix d’un café.Je veux en savoir plus !