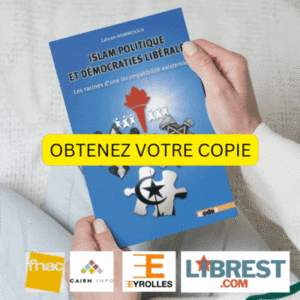Trois jours après le meurtre d’un jeune Malien dans la mosquée de la commune gardoise de La Grand-Combe, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion, a annoncé, lundi 28 avril, la procureure de la République de Nîmes, tandis que le principal suspect du meurtre, un jeune homme d’une vingtaine d’années, s’est rendu dans un commissariat en Italie la veille au soir. Le sociologue et chercheur au CNRS, Julien Talpin, revient sur la montée du racisme anti-musulmans et le « deux poids deux mesures » des réactions politiques.
Comment se caractérise l’islamophobie ? Existe-t-il une spécificité en France ?
Julien Talpin
Sociologue, directeur de recherche au CNRS
C’est un phénomène international, global, qui a fortement augmenté après le 11 septembre 2001. On pourrait citer comme exemple Trump, qui lors de son premier mandat, relaie des vidéos islamophobes d’extrême droite ou qui banalise l’islamophobie après l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande…
Malgré tout, ce phénomène connaît une intensité particulière en France1. Même si les enquêtes comparatives sont difficiles, il s’avère que les déclarations de discriminations en raison de la religion musulmane restent particulièrement importantes dans notre pays. Ce qui peut être relié à différents facteurs. La France représente le pays européen qui compte la population de confession musulmane la plus importante. Elle a été l’un des pays européens le plus touchés par le terrorisme islamiste. Ce qui a aussi contribué à la crispation autour de ces enjeux.
Enfin, le cadre laïc français, s’il ne génère pas mécaniquement de l’islamophobie, peut entretenir un certain flou, avec un sentiment de deux poids deux mesures qui ne favorise pas l’apaisement des relations.
À partir de quand est-on passé d’arabe à musulman. Et quand a-t-on associé le mot musulman systématiquement avec « problème » ?
On peut dire que le tournant date des années 1980, avec des premières affaires qui émergent sur cette question autour des usines automobiles de Poissy et d’Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Les salariés en grève – la plupart maghrébins – vont être qualifiés d’intégristes, de fondamentalistes musulmans. Le premier ministre Pierre Mauroy, ainsi que d’autres membres de son gouvernement, avait fait ce genre de déclarations dans le but de disqualifier un mouvement venu d’ouvriers qui réclamaient uniquement de meilleures conditions de travail.
Les choses vont s’accélérer en 1989 avec une première affaire relative au port du voile. Trois collégiennes sont exclues de leur collège, à Creil, dans l’Oise. Le Conseil d’État va statuer sur le fait que le port de signes religieux par des usagers du service public n’est pas contraire à la loi de 1905 qui s’applique essentiellement aux fonctionnaires mais pas aux usagers du service public. Mais, par la suite, la doctrine va évoluer. Et ce qu’on va appeler la construction du « problème musulman » ne fera que s’amplifier.
Certains ont le sentiment que les actes commis contre les musulmans sont invisibilisés. Peut-on porter ce constat ?
Un recensement effectué par le ministère de l’Intérieur existe, mais il est effectivement circonscrit dans la mesure où il repose quasi essentiellement sur les plaintes déposées par les personnes elles-mêmes. Or, dans tous les actes de racisme, et a fortiori pour les actes contre les musulmans, il existe une sous-déclaration importante.
Elle s’explique par un non-accès au droit, mais aussi le manque de confiance de cette population dans les institutions judiciaires, policières. La comptabilité officielle ne recueille que l’écume des actes discriminatoires qui se produisent. Et puis, il y a presque une spécificité française sur le fait que les acteurs associatifs qui luttent contre les discriminations et sont censés accompagner vers l’accès aux droits sont vus d’un mauvais œil, voire ouvertement attaqués par les pouvoirs publics.
Beaucoup déplorent que les grands médias ne relaient pas les actes contre les musulmans. Y a-t-il vraiment deux poids deux mesures ?
C’est un sentiment très fort partagé par les Français de confession musulmane. Dans l’affaire récente du meurtre du jeune Aboubakar Cissé, tué par plusieurs coups de couteau dans une mosquée du Gard, il y a bien eu deux poids deux mesures quant aux réactions des autorités. On l’a bien vu dans le fait de mettre du temps à réagir, à se déplacer, jusque dans la qualification des termes employés.
Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, et Manuel Valls, ministre des Outre-Mers, parlent d’un acte anti-musulmans mais pas islamophobe. Manuel Valls va jusqu’à reprendre l’idée que le terme islamophobe a été inventé par les mollahs iraniens…
Cette déclaration est une pure fake news. L’islamophobie n’a jamais été inventée par les mollahs iraniens et on peut déplorer que des responsables politiques, des ministres, reprennent des informations erronées qui ont été depuis longtemps infirmées par bon nombre de travaux de spécialistes.
L’islamophobie est un terme qui remonte au début du XXe siècle, employé aujourd’hui par un ensemble d’organisations internationales, tout à fait accepté par le monde de la recherche à l’échelle internationale. La spécificité française – une fois de plus – va jusqu’à la délégation de l’emploi de ce terme. C’est d’une grande violence symbolique.
Dans les enquêtes que je peux mener, les musulmans eux-mêmes en font un usage banal. En revanche, ils ont le sentiment que trop d’énergie est consacrée à cette définition et cette qualification des termes, plutôt que de s’attaquer à la réalité du problème. Alors au fond, parler d’actes anti-musulmans peut leur convenir à partir du moment où derrière, les pouvoirs publics reconnaissent l’ampleur du problème et que des moyens sont débloqués pour lutter contre.
Or, souvent, le refus d’utiliser le mot islamophobie va aussi de pair avec la minimisation de l’ampleur du phénomène. Dans l’enquête que j’ai menée sur les réactions à l’islamophobie des Français de confession musulmane qui décident de quitter la France, ces derniers mettent en avant les discriminations et les problèmes directs qu’ils vivent autour de ces questions-là, mais aussi beaucoup plus largement, ils témoignent d’une atmosphère entretenue par les médias et les pouvoirs publics qui devient étouffante. Et qui peut les conduire à partir.
Le meurtre a eu lieu dans une ancienne ville ouvrière, minière, du Gard. Dans un département où l’extrême droite est extrêmement bien implantée…
Il est trop tôt pour analyser dans quelle mesure le contexte local a été déterminant ou pas. Mais il est tout à fait possible de considérer que la situation nationale, médiatique, peut faciliter, légitimer ce type de passage à l’acte.
Le journal des intelligences libres
« C’est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. »Tel était « Notre but », comme l’écrivait Jean Jaurès dans le premier éditorial de l’Humanité.120 ans plus tard, il n’a pas changé. Grâce à vous. Soutenez-nous ! Votre don sera défiscalisé : donner 5€ vous reviendra à 1.65€. Le prix d’un café.Je veux en savoir plus !