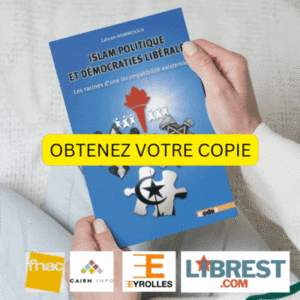Une solution « miracle » en trois petites lettres : CCS. L’industrie européenne détiendrait enfin la clé pour se décarboner, rester dans la compétition mondiale tout en luttant contre le changement climatique. Derrière cet acronyme de Carbon Capture and Storage, aussi appelé « stockage carbone », se cache un ensemble de technologies visant à capter, transporter et stocker le CO2 émis par les usines plutôt que de le laisser s’échapper dans l’atmosphère.
L’incroyable complexité de ces procédés mis bout à bout – captage du dioxyde de carbone en sortie de cheminée, purification, conditionnement, transport par pipelines ou bateaux avant un stockage théoriquement définitif sous la croûte terrestre – n’est pourtant pas la seule inconnue.
Manque de maturité technologique, risque de fuites de gaz ou encore pénalité énergétique induite par son fonctionnement… Ces obstacles n’ont pas empêché le CCS de s’imposer comme la clé de voûte de la stratégie climatique de l’UE en matière de décarbonation de l’industrie.

Une opération d’influence rondement menée. Et qu’importe si les infrastructures n’existent pas encore et si les investissements nécessaires se chiffrent à 520 milliards d’euros d’ici à 2050, selon l’Institut pour l’économie de l’énergie et l’analyse financière (IEEFA).
La solution « miracle » des superpollueurs
Pour comprendre l’avènement du stockage carbone, il faut revenir aux années 1980. Les maillons de cette chaîne de technologie ont été développés par les majors des hydrocarbures. Une extraction très pétrolière que tous les promoteurs du CCS tentent désormais de faire oublier.
Pour les industriels du ciment, des engrais ou encore de l’acier, le CCS est aujourd’hui présenté comme la seule solution pour décarboner leurs activités « hard to abate » – où la réduction des émissions est particulièrement difficile en raison de la nature des processus mais surtout du fait de leur forte dépendance aux combustibles fossiles.
Mais, en un demi-siècle, peu de progrès ont été réalisés. « Il n’y a pas eu d’amélioration des coûts à travers le temps sur les différentes étapes du procédé », assure Guus Dix, chercheur à l’université de Twente (Pays-Bas). Le coût d’une tonne de CO2 stockée à l’aide du CCS oscille entre 100 et 250 €, tandis que la tonne se négocie aux alentours de 60 € sur le marché des quotas d’émissions.
Le CCS s’est toutefois invité pour la première fois dans les travaux du Giec en 2005, jusqu’à s’arroger une place conséquente dans le 6e rapport du groupe d’experts, publié entre 2021 et 2023.
Dans leurs scénarios, les modélisateurs du groupe 3, chargés de trouver les solutions pour atténuer le changement climatique, intègrent le CCS – en dernier recours – afin d’atteindre le « net zero » et capturer à l’horizon 2100 les dernières émissions « résiduelles » (qui n’auront pas pu être réduites par d’autres moyens).
Une hypothèse contestée au sein même du Giec. Pour Yamina Saheb, autrice du 6e rapport d’évaluation, « les émissions ”résiduelles” existent en raison du type de modélisation ». Focalisés sur le CO2 et négligeant les autres gaz à effet de serre, ces modèles ne remettent pas en cause le business as usual et son impact sur le réchauffement climatique. Pour cette chercheuse à Sciences-Po, « on part d’une erreur scientifique et stratégique pour arriver à un résultat convenant parfaitement à l’industrie ».
Une technologie repeinte en vert à l’aide d’un scientifique du Giec
Si le CCS est présent dans les rapports du Giec, il est jugé toutefois moins efficace que l’électrification ou le développement des ciments bas carbone pour réduire les émissions industrielles, tout en étant bien plus cher. Alors, pour renforcer la crédibilité de cette promesse de solution encore loin d’être opérationnelle, rien de tel qu’un scientifique en vue. Le vice-président du groupe 3 du Giec, Oliver Geden, présente le profil idoine.