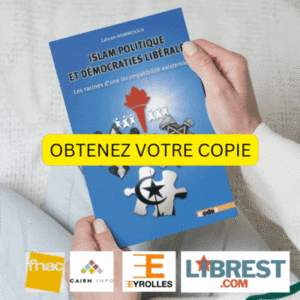De nombreuses universités américaines, largement considérées à l’échelle mondiale comme des balises d’intégrité académique et de liberté d’expression, rendent les demandes de l’administration Trump, qui vise le monde universitaire depuis son entrée en fonction.
Dans l’un de ses premiers actes, le président Donald Trump a marqué les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion comme discriminatoires. Son administration a également lancé des enquêtes fédérales sur plus de 50 universités, de petites écoles régionales telles que la Grand Valley State University dans le Michigan et le New England College of Optometry dans le Massachusetts à des universités privées d’élite telles que Harvard et Yale.
Trump a augmenté la pression en menaçant le financement de la recherche universitaire et en ciblant des écoles spécifiques. Dans un exemple, l’administration Trump a révoqué 400 millions de dollars américains en subventions à l’Université de Columbia pour ses prétendus échecs pour freiner le harcèlement antisémite sur le campus. L’école a ensuite accepté la plupart des demandes de Trump, de resserrer les politiques de protestation des élèves à la mise en place d’un département universitaire entier sous surveillance administrative – bien que le financement reste gelé.
Cornell, Northwestern, Princeton, Brown et l’Université de Pennsylvanie ont également récemment conçu des subventions. Harvard a reçu une liste de demandes afin de maintenir 9 milliards de dollars de financement fédéral.
Maintenant, aux États-Unis, de nombreuses universités tentent d’éviter d’être la prochaine cible de Trump. Les administrateurs démantèlent les initiatives de la DEI – les bureaux de fermeture et de rebrandissement, éliminant les postes, révisant les programmes de formation et désinfectant les déclarations de diversité – tandis que les professeurs sont auto-censurés de manière préventive.
Toutes les institutions ne respectent pas. Certaines écoles, comme Wesleyan, ont refusé d’abandonner leurs principes de diversité. Et des organisations telles que l’American Association of University Professors ont intenté des poursuites en matière de jugement de Trump, faisant valoir qu’ils violaient la liberté académique et le premier amendement.
Mais ceux-ci restent des exceptions, car la tendance plus large se penche vers la prudence et la retraite institutionnelles.
En tant que savant de l’éducation comparative et internationale, j’étudie comment les établissements universitaires réagissent à la pression autoritaire – à travers les systèmes politiques, les contextes culturels et les moments historiques. Alors que certaines universités peuvent croire que le respect de l’administration protégera leur financement et leur indépendance, quelques parallèles historiques suggèrent le contraire.

PHOTO AP
Universités allemandes: une leçon
Dans le livre de 1975 «The Abusing of Learning: The Faiting of German Universities», l’historien Frédéric Lilge raconte comment les universités allemandes, qui sont entrées dans le 20e siècle dans un âge d’or de l’influence intellectuelle mondiale, n’ont pas résisté au régime nazi mais qui s’y adapte à la place.
Avant même de saisir le pouvoir national en 1933, le parti nazi surveillait étroitement les universités allemandes par le biais de groupes d’étudiants nationalistes et de professeurs sympathiques, qui a signalé des professeurs jugés politiquement peu fiables – en particulier les juifs, les marxistes, les libéraux et les pacifistes.
Après que Hitler ait pris ses fonctions en 1933, son régime a déménagé rapidement pour purger les institutions universitaires des Juifs et des opposants politiques. La loi de 1933 pour la restauration de la fonction publique professionnelle a exigé le licenciement des professeurs juifs et autres «non aryens» et membres de la faculté jugés politiquement suspects.
Peu de temps après, les professeurs devaient jurer la loyauté envers Hitler, les programmes ont été révisés pour souligner la «défense nationale» et la «science raciale» – un cadre pseudoscientifique utilisé pour justifier l’antisémitisme et la suprématie aryenne – et des départements entiers ont été restructurés pour servir l’idéologie nazi.
Certaines institutions, telles que Technische Hochschule Stuttgart, se sont même précipitées pour honorer Hitler avec un doctorat honorifique dans les semaines suivant son ascension au pouvoir. Il a refusé l’offre, bien que le geste ait signalé l’empressement de l’université de s’aligner sur le régime. Les associations professionnelles, telles que l’Association des universités allemandes, sont restées silencieuses, ignorant les principales opportunités de résister avant que les universités ne perdent leur autonomie et ne servaient pas à l’État nazi.
Comme le linguiste Max Weinreich l’a écrit dans son livre de 1999 «Hitler’s Professors», de nombreux universitaires ne se sont pas conformés, ils ont permis le régime en remodelant leurs recherches. Cette doctrine d’état légitimée, aidant à construire le cadre intellectuel du régime.
Quelques universitaires ont résisté et ont été licenciés, exilés ou exécutés. La plupart ne l’ont pas fait.
La transformation du monde universitaire allemande n’était pas une dérive lente mais une refonte rapide et systémique. Mais ce qui a fait que les ordres d’Hitler Stick, c’est l’empressement de nombreux dirigeants universitaires de se conformer, de justifier et de normaliser le nouvel ordre. Chaque décision – chaque nom effacé, chaque programme révisé, chaque programme et département fermé – a été conçu comme nécessaire, voire patriotique. En quelques années, les universités allemandes ne servaient plus de connaissances – elles ont servi le pouvoir.
Il faudrait plus d’une décennie après la guerre, par la dénazification, le réinvestissement et la réintégration internationale, pour que les universités ouest-allemands commencent à retrouver leur position intellectuelle et leur crédibilité académique.

AP Photo / Zander Hollander
L’URSS et l’Italie fasciste subissent un sort similaire
D’autres pays tombés sous des régimes autoritaires ont suivi des trajectoires similaires.
En Italie fasciste, le changement n’a pas commencé avec la violence mais avec une signature. En 1931, le régime de Mussolini exigeait que tous les professeurs d’université procurent un serment de loyauté envers l’État. Sur plus de 1 200, seulement 12 ont refusé.
Beaucoup ont justifié leur conformité en insistant sur le fait que le serment n’avait aucune incidence sur leur enseignement ou leur recherche. Mais en affirmant publiquement la loyauté et en n’offrant aucune résistance organisée, la communauté universitaire a signalé sa volonté de s’adapter au régime. Ce manque d’opposition a permis au gouvernement fasciste de resserrer le contrôle des universités et de les utiliser pour faire progresser son programme idéologique.
Dans l’Union soviétique, ce contrôle ne se limitait pas aux gestes symboliques – il a remodelé l’ensemble du système académique.
Après la révolution russe en 1917, les bolcheviks ont oscillé entre vouloir abolir les universités en tant que «reliques féodales» et les réutiliser pour servir un État socialiste, en tant qu’historiens John Connelly et Michael Grüttner dans leur livre «Universités sous dictateur». En fin de compte, ils ont choisi ce dernier, refantant des universités comme instruments d’éducation idéologique et de formation technique, étroitement alignés sur les objectifs marxistes-léninistes.
Sous Josef Staline, la survie académique dépendait moins du mérite savant que de la conformité à la doctrine officielle. Les chercheurs dissidents ont été purgés ou exilés, l’histoire a été réécrite pour glorifier le Parti communiste, et des disciplines entières telles que la génétique ont été remodelées pour s’adapter à l’orthodoxie politique.
Ce modèle a été exporté dans l’Europe orientale et centrale pendant la guerre froide. En Allemagne de l’Est, en Tchécoslovaquie et en Pologne, les ministères ont dicté des programmes, le marxisme-léninisme est devenu obligatoire d’une discipline à toutes les disciplines, et les admissions ont été repensées pour favoriser les étudiants issus de horizons loyalistes. Dans certains contextes, les adhérents aux traditions intellectuelles plus anciennes ont repoussé, en particulier en Pologne, où la résistance a ralenti, mais n’a pas pu empêcher l’imposition d’un contrôle idéologique.
Au début des années 1950, les universités de la région étaient devenues ce que Connelly appelle des «institutions captives», dépouillés d’indépendance et refondues pour servir l’État.
Un exemple plus récent est la Turquie, où, à la suite du coup d’État en 2016, plus de 6 000 universitaires ont été rejetés, les universités ont été fermées et la recherche jugée «subversive» a été interdite.
Avertissement de l’histoire
L’intervention précoce et directe de l’administration Trump dans la gouvernance de l’enseignement supérieur fait écho aux tentatives historiques de faire passer les universités sous l’influence ou le contrôle de l’État.
L’administration dit qu’il le fait pour éradiquer les politiques «discriminatoires» de la DEI et combattre ce qu’elle considère comme un antisémitisme sur les campus universitaires. Mais en retenant le financement fédéral, l’administration essaie également de forcer les universités dans la conformité idéologique – en dictant dont les connaissances comptent mais aussi dont la présence et les perspectives sont permis sur le campus.
La réaction de Columbia aux demandes de Trump a envoyé un message clair: la résistance est risquée, mais la conformité peut être récompensée – bien que les 400 millions de dollars ne soient pas encore restaurés. La vitesse et la portée de ses concessions ont créé un précédent, signalant à d’autres universités que d’éviter maintenant les retombées politiques peut signifier des politiques de réécriture, de remodeler les départements et de se retirer de la controverse, peut-être avant même que quiconque ne demande.
L’administration Trump a déjà déménagé dans d’autres universités, notamment l’Université de Pennsylvanie sur ses politiques transgenres, Princeton pour ses programmes climatiques et Harvard sur l’antisémitisme présumé. La question est de savoir quelle école est la prochaine.
Le ministère de l’Éducation a lancé des enquêtes sur plus de 50 établissements, les accusant d’utiliser «les préférences raciales et les stéréotypes dans les programmes et activités de l’éducation». La façon dont ces établissements choisissent de répondre peuvent déterminer si l’enseignement supérieur reste un espace pour une enquête ouverte.
La pression pour se conformer n’est pas seulement financière – elle est aussi culturelle. Il est conseillé aux professeurs de certaines institutions de ne pas utiliser «DEI» dans les e-mails et la communication publique, avec des avertissements pour ne pas être une cible. Les universitaires retirent les pronoms de leurs signatures de courrier électronique et demandent également à leurs étudiants de se conformer. J’ai été à la réception de ces avertissements, tout comme mes homologues dans d’autres institutions. Et les étudiants en visas sont avertis de ne pas voyager en dehors des États-Unis après que plusieurs ont été expulsés ou niés de rentrée en raison d’une prétendue implication dans les manifestations.
Pendant ce temps, les personnes à l’intérieur et à l’extérieur du monde universitaire cèchent des sites Web, des programmes, des présentations et des écrits publics à la recherche de ce qu’ils considèrent comme des infractions idéologiques. Ce type de surveillance par les pairs peut récompenser le silence, inciter l’effacement et retourner les institutions contre les leurs.
Lorsque les universités commencent à réglementer non seulement ce qu’elles disent, mais ce qu’elles enseignent, soutiennent et soutiennent – motivée par la peur plutôt que par le principe – elles ne réagissent plus aux menaces politiques, elles les internaliseront. Et comme l’histoire l’a montré, cela peut marquer le début de la fin de leur indépendance académique.