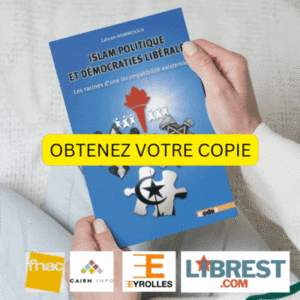Travailler sept heures gratuitement tous les ans pour éponger le déficit ? L’idée, baroque, avait été votée en novembre 2024 par les sénateurs sous l’éphémère gouvernement de Michel Barnier, avant d’être enterrée par l’Assemblée nationale.
Mais voilà que plusieurs ministres de François Bayrou disent tout le bien qu’ils pensent de cette mesure, invitant les parlementaires à plancher de nouveau sur le sujet. Dans un entretien au très droitier « JDD », Catherine Vautrin, ministre du Travail, déclare : « Les sénateurs, dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) qu’ils ont voté, proposent de travailler sept heures de plus dans l’année, soit dix minutes de plus chaque semaine. (…) Cette mesure peut, en 2025, générer deux milliards d’euros de recettes fléchées vers les dépenses sociales. »
Une « piste sur la table »
Message aussitôt repris et martelé par Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics, qui assure que c’est une « piste sur la table » : « La proposition que les sénateurs ont mise sur la table, c’est que, pour le grand âge, pour les Ehpad, pour l’accompagnement de la dépendance, il y avait la possibilité que, par le travail – c’est l’esprit de la Sécurité sociale -, nous arrivions à donner plus de moyens aux sujets qui inquiètent les Français. »
On imagine qu’Ambroise Croizat, l’un des pères fondateurs de notre système de protection sociale, s’est retourné dans sa tombe en écoutant cette tirade : invoquer l’ « esprit » de la Sécu pour faire travailler les gens gratuitement, il fallait oser…
Il s’agit en fait de s’inspirer du principe de la journée de solidarité, instituée par la loi en juin 2004. En contrepartie de ces heures travaillées mais non payées, les employeurs publics et privés versent une contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) à hauteur de 0,3 % de la masse salariale (ce montant correspondant au surcroît estimé de valeur ajoutée d’un jour de travail).
Le gouvernement Bayrou laisse entendre que les sept heures supplémentaires seraient réparties dans l’année, après discussion entre les « partenaires sociaux » (patronat et syndicats). En contrepartie, les patrons verraient leur taux de contribution de solidarité pour l’autonomie augmenter de 0,3 % à 0,6 %.
72 % des actifs opposés
Lorsqu’elle avait déjà été débattue en fin d’année dernière, la proposition avait déclenché un tollé chez les syndicats et la gauche. « Ce serait de nouveau 7 heures de travail non rémunérées à un moment où le pouvoir d’achat est en berne, que les salaires n’évoluent pas ou peu et que les annonces de plans de suppressions d’emplois ne cessent de se succéder », tonnait par exemple la CGT.
Même indignation à gauche. « C’est un scandale de demander aux gens d’avoir un travail gratuit quand depuis trois ans, les salariés ont déjà largement payé puisque le salaire réel baisse », assénait François Ruffin, tandis que la communiste Cathy Apourceau-Poly proposait, avec ironie, une « journée de solidarité des dividendes » pour faire contribuer les actionnaires.
On peine, en effet, à trouver le moindre argument rationnel pour défendre une proposition qui rapporterait finalement très peu (deux milliards d’euros semblent une goutte d’eau dans l’océan des 150 milliards d’euros de déficit public français), pour un coût politique considérable (72 % des actifs étaient opposés à l’idée d’une deuxième journée de solidarité, selon un sondage Elabe pour « BFM TV » en octobre dernier). Même certains macronistes se sont insurgés : le député Mathieu Lefèvre a fustigé une « idée anti-travail », rappelant que « le travail doit payer ».
Aux côtés de celles et ceux qui luttent !
L’urgence sociale, c’est chaque jour la priorité de l’Humanité.
En exposant la violence patronale.
En montrant ce que vivent celles et ceux qui travaillent et ceux qui aspirent à le faire.
En donnant des clés de compréhension et des outils aux salarié.es pour se défendre contre les politiques ultralibérales qui dégradent leur qualité de vie.
Vous connaissez d’autres médias qui font ça ? Soutenez-nous !Je veux en savoir plus.